Le coup d’envoi pour le plus grand rassemblement écologique au monde, la COP27, a été donné en Égypte ce week-end, et tous les yeux sont braqués sur les dirigeants du monde. Tandis qu’à Maurice, la semaine dernière, s’est tenue la toute première conférence sur l’écologie organisée, entre autres, par le Center for Alternative Research & Studies (CARES), suivie d’une semaine de colloque résidentiel à Riambel où de nombreux intervenants et chercheurs de différentes parties du monde sont intervenus. Samedi dernier, la thématique choisie fut particulière.
Pendant une journée entière, des femmes mauriciennes, malgaches, sud-africaines et autres nationalités ont parlé de l’écoféminisme, soit du rôle fondamental de la femme dans le combat pour la planète. Car au-delà des grands discours politiques, quand il n’y a plus rien à manger, quand leurs familles sont menacées, ce sont avant tout ces « mères admirables », « ces mères courage » qui, instinctivement, prennent les devants…
Si le terme semble nouveau, dans la pratique, l’écoféminisme existe depuis des millénaires, car la femme, quel que soit le combat, s’est toujours battue pour la survie de la communauté.
Ainsi, les chercheurs définissent l’écoféminisme — terme issu de la contraction des mots « écologie » et « féminisme » — comme étant la relation qui existe entre l’exploitation et la domination de la nature par les hommes, ainsi que l’exploitation et l’oppression des femmes par les hommes. Une définition qui pourrait froisser, voire agacer, d’autant que le féminisme lui-même reste un mouvement encore incompris. Mais dans l’optique de replacer l’humain au centre des débats écologiques, politiques et économiques, la femme a aujourd’hui plus que jamais son mot à dire.
Par ailleurs, beaucoup s’accordent à dire que le vrai changement est amené par la femme, et d’ailleurs, les mouvements de révolte sont souvent initiés par des femmes, bien que plus discrètes. En effet, parmi les nombreux exemples, l’on apprend que pendant les douze années de guerre révolutionnaire qui ont déchiré le Salvador entre 1981 et 1992, un guérillero sur trois était une femme. À Maurice, nous nous souvenons du Wakashio et du rôle des femmes du Sud qui sont montées au créneau pour tenter de sauver le lagon à coups de fil et d’aiguilles pour confectionner ces « boue sarlon » ou encore la manifestation pour l’eau à Bambous Virieux fin 2021… Week-End s’est entretenu avec des femmes des îles de l’océan Indien sur ce mouvement pas si nouveau que ça.
— — — — — — —
Babita Thanoo (île Maurice) :
« Il est important de traduire cette théorie en actions »
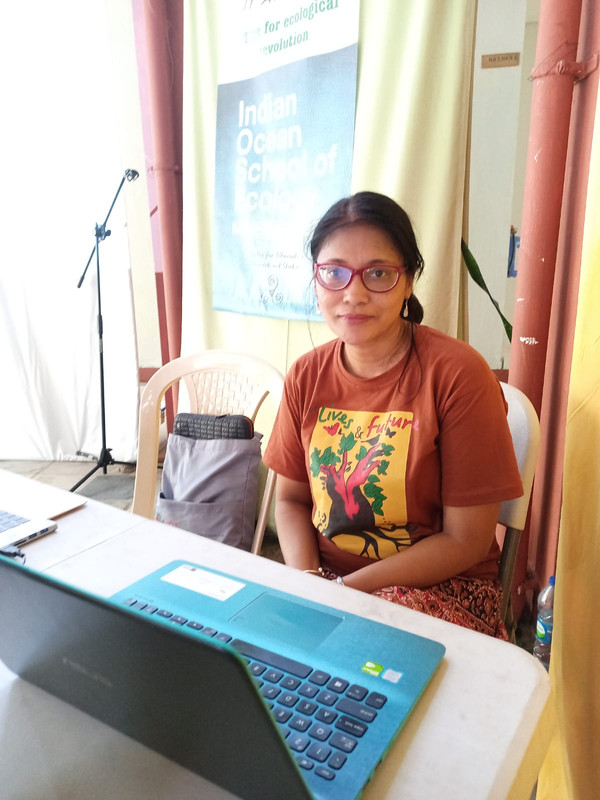
Babita Thanoo est chargée de cours pour CARES depuis quelques années déjà et essaie d’expliquer en des termes simples et pratiques la théorie de l’écoféminisme. « Je suis là pour partager ma connaissance et surtout pour faire prendre conscience de l’importance de l’écoféminisme dans les mouvements sociaux. Il est important de traduire cette théorie en actions et l’écoféminisme est d’autant plus important, voire fondamental, dans les îles, car dans les sociétés indigènes, ce sont souvent les femmes qui apportent les changements, notamment à travers les pratiques d’agroécologie. Aujourd’hui, il est important de retourner à la méthode indigène, aux modes de vie et aux valeurs indigènes, et même si certains voient cela comme une décroissance ou une régression, ce n’est nullement le cas. Il faut juste revoir nos valeurs et le système, et arriver à comprendre que les femmes peuvent apporter le changement. »
— — — — — — —
Lindi We (Afrique du Sud) :
« L’exploitation humaine des terres agricoles liée à l’écoféminisme »

South African Villagers Win Suit to Halt Shell’s Oil Exploration : c’est le titre d’un article du New York Times publié le mois dernier. Et devinez qui est à la tête de ce mouvement de villageois ? Une femme. Lindi We est une activiste sud-africaine et c’est elle qui nous a parlé de ces villageois qui ont réussi à faire tomber cette grosse franchise internationale. « Une femme était à la tête de ce mouvement et même si les femmes activistes sont plus discrètes, elles sont bel et bien là à travailler aux côtés des hommes. En Afrique du Sud, les femmes sont en effet très engagées quand il y a une quelconque menace sur leur source de nourriture surtout, car elles ont le rôle de produire de la nourriture pour leurs familles. Donc, l’exploitation humaine des terres agricoles et des ressources naturelles du pays reste une priorité pour elles et elle est intimement liée au combat écoféministe », dit-elle.
— — — — — — — — —
Jade Jourdan (île de La Réunion) :
« Notre but ce n’est pas d’exclure les hommes, mais de les inclure »

La Réunionnaise Jade Jourdan souhaite, elle, inclure les hommes dans le débat écoféministe. « Tout ce qui concerne le climat, l’écologie et le militantisme, c’est très important. Être activiste de nos jours est essentiel pour être dans la résistance, mais surtout pour être dans les alternatives pour sortir de ce système capitaliste et essayer de se solidariser entre nous et de solidariser tous les peuples de l’océan Indien. À La Réunion, on n’est pas encore arrivés à l’écoféminisme. En fait, au début on parlait de féminisme, mais des fois peut-être avec certains mouvements extrêmes féministes, c’est compliqué. Les gens sont déstabilisés et on a donc créé un mouvement qui s’appelle “Sororité”. Ce qui passe mieux ! Notre but ce n’est pas d’exclure les hommes, mais de les inclure, c’est de s’autoéduquer entre nous et d’échanger quotidiennement pour changer ce côté patriarcal. »
— — — —
Zo Andriamananenasoa Randriamaro (Madagascar) :
« Les gens se braquent en entendant le mot féminisme »
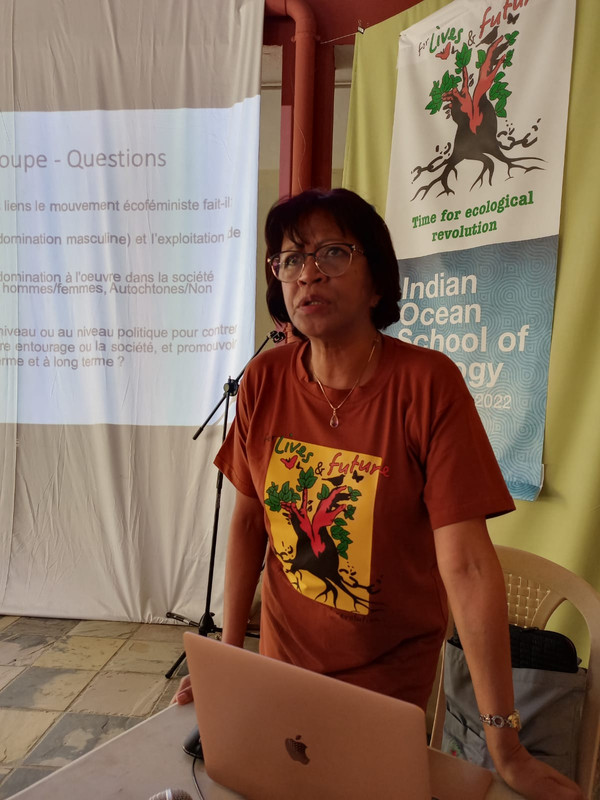
Zo Andriamananenasoa Randriamaro, théoricienne et activiste malgache, milite pour que l’écofeminisme fasse partie de toutes les discussions pour lutter contre la crise écologique. « Je suis ici à Maurice pour participer à cette école d’écologie et ce n’est pas la première fois. J’ai discuté lors de mon intervention de ce mouvement en tant que mouvement politique vers le changement. Dans le cas de Madagascar et à travers la vidéo que j’ai partagée plus tôt, elle concerne une lutte des femmes sur la préservation des ressources naturelles et la protection de l’héritage. Cette femme-là ne sait pas qu’elle est écoféministe, mais elle l’est. En fait, c’est nous qui qualifions sa lutte d’écoféminisme. Actuellement, l’écoféminisme en tant que mouvement politique n’est pas encore connu et encore moins reconnu, et c’est quelque chose que nous essayons de mettre sur la table, surtout lorsqu’on parle de stratégies pour lutter contre la crise climatique, et c’est à travers ces canaux qu’on essaie de promouvoir l’écoféminisme en tant que mouvement à Madagascar. Il est vrai que les gens se braquent en entendant le mot féminisme et c’est pour cela qu’on a du mal, car le féminisme pose problème. Madagascar ne fait pas exception aux autres sociétés africaines où le système patriarcal est encore très fort et dominant. Donc, nous pensons que la tâche ne va pas être facile, mais pour nous, l’écofeminisme doit faire partie de toutes les discussions pour lutter contre la crise écologique et nous amener vers cette révolution écologique et la reconnaissance des droits de la nature. En Amérique latine, il y a la Constitution de la Bolivie qui intègre explicitement les droits de la nature, et cela est un encouragement. »
— — — — —
Toilha Saïd toilha dhoiharatte (Comores) :
« Nous subissons tous la dégradation de l’environnement »
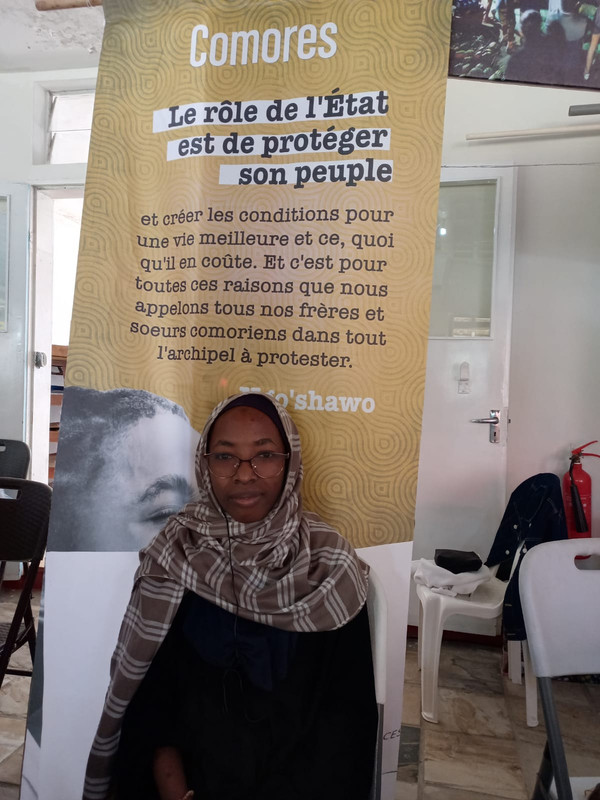
Toilha Saïd toilha dhoiharatte est membre d’une association comorienne axée sur l’écologie. Si le mouvement écoféministe n’y a pas encore été formellement développé, elle nous explique que les femmes comoriennes sont très engagées dans le combat écologique, car la mer, c’est elle qui les nourrit. « Au niveau de l’association, on a plusieurs activités dans l’éducation, l’environnement et l’engagement citoyen sur l’environnement. Après discussions, nous nous rendons compte que les problèmes des Comores sont les mêmes que ceux de Maurice, des Seychelles ou du Sénégal, par exemple, parce que nous subissons tous la dégradation de l’environnement causée par nos activités humaines qu’on ne peut pas éliminer ou arrêter, car notre survie en dépend. Cela est très malheureux. Par exemple, aux Comores, nous avons un gros problème d’extraction de sable pour la construction et du pillage des mangroves. Sans le sable et les barrages naturels, le niveau de la mer ne cesse de monter et nous essayons de sensibiliser au maximum les habitants des régions côtières surtout. »
— — —
Josiane Larose (Seychelles) :
« Nos problèmes sont les mêmes. On a un seul océan ».

Josiane Larose est membre de l’Association de femmes seychelloises. « Nos problèmes sont les mêmes. On a un seul océan et toutes nos îles subissent les mêmes conséquences de la crise. Aux Seychelles, les femmes sont très impliquées dans ce combat, car nous en dépendons pour survivre, et nous avons la chance d’avoir des législations qui nous permettent de faire entendre nos voix. L’écoféminisme, nous le pratiquons tous les jours, même si on n’a jamais su le nommer. »
— — — — —
Natacha Magraja (Maurice) :
« Le Wakashio a prouvé que nos femmes sont fortes »

Habitante de Mahébourg, Natacha Magraja a vécu l’épisode Wakashio du début à la fin. Pour elle, la femme mahébourgeoise et des régions avoisinantes ont fait preuve de courage lors de cette épreuve. « Nous les femmes donnons la vie, et voyant cette mer qui nous nourrit dans un tel état a été un déclic. Je pense que les femmes ont été plus sensibles à la douleur associée à un tel drame, même si évidemment tous les citoyens hommes ou femmes ont souffert et souffrent encore de ce drame écologique. Le Wakashio a prouvé que nos femmes sont fortes en termes d’organisation, car elles gèrent tellement de choses dans leurs foyers et elles sont capables d’accomplir des choses extraordinaires. Nous, nous sommes des gens simples, des gens de mer, mais imaginez-vous si nous placions davantage de femmes à des postes à haute responsabilité ? »



