DENIS PATRICE LEBON
Dans la course effrénée à la célérité économique et à l’excellence civilisationnelle, dans l’horizon immémorial de la décennie à venir, l’île Maurice devrait transcender l’ordinaire pour s’ériger, à l’horizon 2035, en épicentre de la prospérité insulaire. Cette métamorphose ne saurait se contenter d’ajustements graduels ni de discours politiques lénifiants : elle exigerait une audace conceptuelle et une précision chirurgicale où chaque réforme se voudrait le vecteur d’un saut quantique. Pour que l’archipel, jadis simple relais touristique et financier, devienne une « fabrique civilisationnelle », il lui faudrait inventer son futur dans l’entrelacs des révolutions énergétiques, agroécologiques, industrielles, touristiques, numériques, financières, géopolitico‑économiques et diplomatiques qui redessineraient déjà les contours de l’Indopacifique, afin de se propulser en gagnante dans le firmament de l’exemplarité économique. Ce ne serait point une simple modernisation qu’il s’agirait d’engager, mais bien la naissance d’un « archipel‑système », où chaque réforme s’entortillerait à la suivante dans un ballet cohérent et parfaitement harmonisé, visant à faire de l’archipel mauricien le parangon de la prospérité et de l’innovation pour tout l’océan Indien, le continent africain et bien au‑delà.
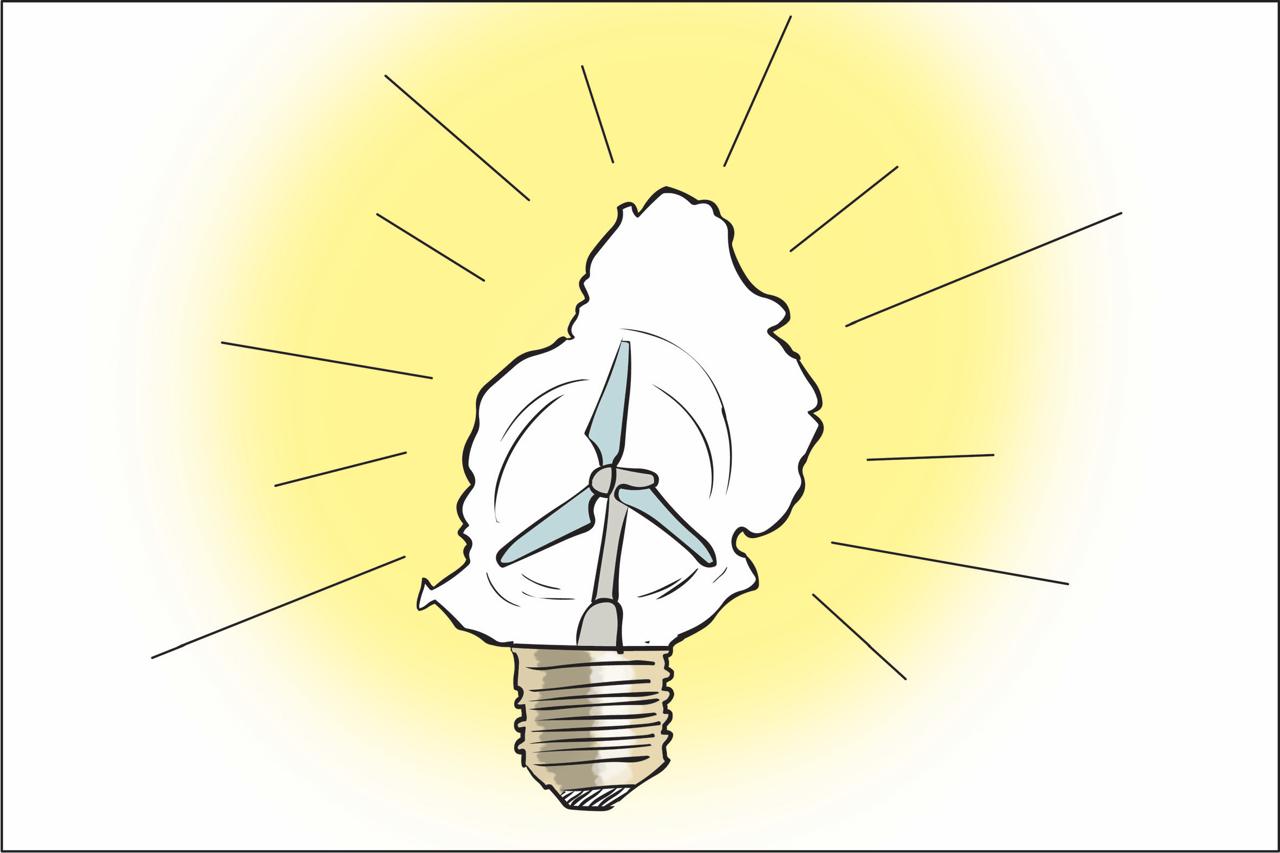
Au commencement de cette mutation, il serait loisible d’imaginer un pacte social mauricien qui ne se contenterait plus de drainer des ressources, mais instillerait la justice sociale, une révolution suscitant une onde de choc planétaire du système fiscal, libéré de la gangue du tax havenism. Un terraformage fiscal où chaque tranche de revenu serait modulée avec une finesse semblable à de la haute joaillerie, permettant de comprimer l’indice de Gini sous 0,35 tout en instituant un dividende carbone universel dynamique, indexé sur le cours européen du CO2 et redistribué à chaque foyer pour internaliser le coût collectif des émissions. On y associerait une taxe spéculative sur les acquisitions foncières destinée à juguler l’envolée des prix immobiliers et à préserver le foncier agricole, le tout adossé à l’adoption intégrale des normes BEPS de l’OCDE, garantissant une transparence fondée sur l’équité et la responsabilité à l’épreuve des plus redoutables audits internationaux.
Parce que la maîtrise de l’énergie est l’âme de cette révolution, Maurice déploierait un bouquet énergétique pluritech pour atteindre un mix 100 % renouvelable d’ici 2035 et exporter de l’électricité verte vers La Réunion, Madagascar et d’autres îles de la région via des câbles d’interconnexion offshore à courant continu haute tension (CCHT), posés à des milliers de mètres, dédiés à l’électricité et non aux données. Des hydroliennes de petite taille ceinturant les lagons produiraient plusieurs MW d’une électricité propre et quasi constante, inoffensives pour la faune, rendant le chalutage impraticable et, pour certains modèles, créant des barrières artificielles ; l’énergie serait acheminée vers différentes destinations par ces mêmes câbles d’interconnexion. L’hydrogène vert, issu d’électrolyseurs couplés à des parcs solaires de 80 MW, alimenterait transport lourd et industrie, jusqu’à réduire considérablement la combustion de fioul. Aux estuaires, la biomasse marine — notamment les algues sargasses — serait transformée en biogaz et en fertilisants organiques, bouclant l’économie circulaire et soutenant un Blue-Green Ocean Corridor innovant. Cette synergie ferait de Maurice l’atelier privilégié de la transition bas-carbone.
Tandis que le soleil et la mer se feraient forces motrices, les terres intérieures devraient elles aussi se réinventer. À l’heure où l’île couvre moins de 30 % de ses besoins alimentaires par sa production locale, une révolution agroécologique d’une ampleur inédite pourrait s’imposer. Des fermes verticales high‑tech, érigées dans les friches urbaines de Port‑Louis jusqu’au fin fond de Rivière-du-Rempart, après avoir fait escale à La Cure et Calebasses, combineraient hydroponie, aquaponie, peut-être même le projet économique ultra-innovant et hyper-disruptif MarInsectaPonics®™ et l’IA, quadrupleraient les rendements tout en divisant par deux les intrants. Drones agricoles, bardés de capteurs multispectraux, analyseraient en temps réel la vigueur des cultures et l’humidité des sols, optimisant l’irrigation, l’épandage d’engrais et la plantation synchronisée. Un label « AgroMaurice Premium » ouvrirait des marchés de niche à haute valeur vers l’Union européenne, les États‑Unis, l’Asie et autres marchés porteurs, transformant chaque hectare cultivé en mission d’excellence écoresponsable. Une Banque verte d’investissement, dotée de 5 % du PIB, financerait ces innovations à l’échelle panafricaine, faisant de Maurice un pôle d’exportation de denrées et d’exotechnologies agribiotech numériques.
À la flamboyance verte s’ajouterait une renaissance industrielle : au-delà de la Cybercité, un Techno Industrial District (TID) de rang mondial réunirait cellules robotisées/cobotisées et imprimantes 3D de dernière génération (biomédecine, nanotechnologies, pièces aéronautiques, sur-mesure, entre autres technologies de pointe). Porté par un fonds de capital-risque de 200 M € et un partenariat OIF–Commonwealth, il attirerait les champions des industries 4.0/5.0, avec un cap limpide : porter l’industrie de 18,56 % à 25 % du PIB en 2035 et former annuellement 2 000 ingénieurs spécialisés. En parallèle, un maillage numérique ferait de Maurice un hub Indopacifique : une Agence de régulation numérique Indopacifique (ARNI) garantirait la souveraineté des données dans un cloud certifié ISO 27001, interopérable RGPD et édicterait un Ethicode open source pour encadrer l’IA, la blockchain et les contrats intelligents publics. La fiscalité des actifs numériques (NFT, tokens de données, cryptoactifs, etc.) générerait dès 2026 plus de 50 M €, consacrant Maurice en trait d’union électronique entre Afrique francophilophone /anglophone et marchés asiatiques en plein essor.
Pour pérenniser ce montage audacieux, il faudrait un capital humain d’élite, pierre angulaire de toute souveraineté. Maurice déploierait son plan Marshall éducatif, indemne des querelles idéologiques, népotiques ou même communautaristes : l’enseignement de la pensée computationnelle dès la maternelle, 80 heures annuelles de codage au primaire, mais aussi du no-code, et la transformation de chaque université en centre d’excellence accrédité par les meilleures fédérations européennes. Le « Visa Savoir Maurice » attirerait au moins 5 000 chercheurs étrangers, tandis qu’un fonds de USD 300 millions financerait des bourses postdoctorales, faisant de l’archipel une étape obligée pour les talents d’Afrique, d’Amérique du Nord et du Sud, d’Asie et d’Europe.
Sur le plan financier, la Bourse mauricienne se muerait en un Indopacific Impact Exchange, ordonnançant l’émission annuelle de green and blue bonds pour un montant cumulé de USD 2 milliards et instituant un index ESG régional, référence pour les investisseurs institutionnels. Les sukuks verts, émis en partenariat avec les institutions du Golfe persique, pourraient quant à eux financer les infrastructures durables et les ports de nouvelle génération, assurant à Maurice un rôle central dans la logistique maritime de pointe de l’océan Indien.
Le tourisme profiterait aussi d’une mue radicale, passant du all‑inclusive à la Mauritius Regenerative Experience : : écovillages intelligents en matériaux biosourcés séquestrant 30 000 t de CO2₂/an ; immersion culturelle certifiée UNESCO, associant artisans et communautés locales ; cures de très haut vol mêlant thalassothérapie, neurosciences et médecine régénérative/intégrative, cette dernière facturée 5 000 € la semaine et ciblant une clientèle ultra premium. La finalité : diminuer les flux touristiques et maximiser les retombées économiques et environnementales par visiteur, tout en divisant au moins par deux le nombre de touristes. Cet alignement de réformes suppose un État-stratège algorithmique décentralisé, intelligent et hyperagile : plateforme blockchain pour la transparence du budget participatif pour Agaléga, et même pour Rodrigues ou autres futurs pôles, tandis qu’une identité numérique nationale (Mobile-ID) automatiserait 95 % des démarches : éradication de la corruption, délais de traitement de dossier divisés par trois, etc., et allocation prédictive des ressources via des modèles économétriques sophistiqués, optimisant simultanément rendement social et fiscal.
Viendrait s’adjoindre une économie symbiotique permacirculaire, où la transformation simultanée des déchets urbains, agricoles et marins donnerait naissance à un biopolymère insulaire, capable de substituer 70 % du plastique fossile et d’alimenter des filières locales de chimie verte intégrée. L’île déploierait aussi son hub quantique et neurotechnologique, hébergeant un centre de recherche en calcul quantique appliqué à la climatologie et à la cryptographie, ainsi qu’une unité de R & D en interfaces cerveau‑machine, destinées à optimiser la performance cognitive et l’accompagnement innovant des seniors, consolidant ainsi Maurice comme foyer de la prochaine frontière scientifique. On pourrait également y instaurer un métacampus immersif transocéanique : un univers d’éducation en réalité mixte où étudiants mauriciens et internationaux se rencontreraient dans des amphithéâtres virtuels, encadrés par des professeurs holographiques et des IA tutrices, garantissant une diffusion globale et individuelle, au besoin, du savoir, tout en rendant notre « île Monde » incontournable sur la scène académique planétaire.
La doctrine du « Mauricianisme indopacifique » parachèverait l’édifice : via des partenariats triangulaires (Inde–Afrique–Maurice, Japon–Mascareignes–Maurice, ASEAN–Maurice–UE, etc.), l’archipel déploierait une diplomatie économique et algorithmique inédite. Un fonds souverain de USD 10 milliards — la Mauritius Strategic Investment Authority — financerait des infrastructures critiques en Afrique et des corridors logistiques transocéaniques, plaçant Maurice au cœur des coopérations Sud–Sud et Nord–Sud. Des accords régionaux de justes échanges ciblés, en substitution aux libres-échanges surannés (i.e. avec la Communauté de l’Afrique de l’Est, les Maldives, le Vietnam), scelleraient cette géoéconomie à l’échelle Indopacifique. D’ici 2035, libérée de ses carcans, Maurice deviendrait une cité archipélienne où prospérité rime avec soutenabilité et durabilité, innovation avec humanisme et érudition, ambition avec responsabilité : la vision devenue praxis. Non plus simple point sur la mappemonde, mais île-phare prouvant, par 12 leviers, maniés avec pétulance, que la grandeur d’un État-nation océanique tient moins à la taille et aux ressources qu’à l’audace, la cohérence, la volonté, le courage et, surtout, l’intelligence collective d’un projet biocivilisationnel dont il serait le digne porteur.



