À l’occasion de la Journée du Droit de l’Institut Français de Maurice (IFM) le jeudi 6 novembre, une table ronde sur le thème « La peine de mort à Maurice : quelles perspectives humaines et juridiques, quels enjeux et questionnements du point de vue du respect des droits de l’Homme ? » a été organisée dans les locaux de l’institution.
L’événement, une initiative de l’ambassade de France à Maurice et France Alumni, en partenariat avec les grandes institutions académiques de l’île, vise à engager la conversation sur la peine de mort et l’engagement de la France en faveur de son abolition. Parmi les intervenants principaux figuraient Vinod Boolell (ancien juge de la Cour suprême et juge international auprès des Nations unies), Nataraj Muneesamy (Directeur adjoint des Poursuites Publiques-Office du DPP) et Touria Prayag (Membre de la Human Rights Division de la National Human Rights Commission). Prenant en compte l’importance de ce débat, Le Mauricien a rencontré Vinod Boolell ainsi que le leader du PMSD, Xavier-Luc Duval. Ce dernier avait fait son entrée au gouvernement en 1995 à condition que la peine de mort soit abolie. Il raconte dans quelles circonstances son père, Sir Gaëtan Duval et lui-même avaient obtenu l’abrogation de la peine de mort à Maurice.
Touria Prayag, membre de la Commission des droits de l’homme
L’abolition mauricienne un choix politique,
non un principe constitutionnel
Il s’agit d’extraits de l’intervention de Touria Prayag qui participait à la table ronde consacrée à la peine de mort organisée par l’IFM. Elle considère que l’abolition mauricienne est un choix politique et non un principe constitutionnel, et donc reste fragile.
« Pour nous, à la Commission des droits de l’homme, nous ne croyons pas dans la justice punitive, mais dans la justice réparatrice, qui se base sur le principe d’humaniser la justice pour protéger la société : réconcilier, réformer, réhabiliter et offrir une seconde chance.
Pour Maurice, cela suppose d’inscrire le droit à la vie dans la Constitution comme valeur suprême de l’ordre juridique, et de renforcer les programmes de réhabilitation des détenus. Car nous avons encore de gros problèmes, malgré la bonne volonté.
« Quand nous parlons du droit à la vie, il ne s’agit pas de transiger sur la protection de la société. Bien au contraire : la protection de la vie et celle de la société ne s’opposent pas, elles s’articulent. C’est en garantissant les droits fondamentaux que l’État renforce la confiance et la sécurité collective.
« L’État de droit est un État qui protège la société sans renoncer à son humanité. La peine de mort, elle, nie la possibilité de réhabilitation et entretient une culture de violence institutionnelle.
« Dans un État moderne, la légitimité de la justice ne peut pas se fonder sur la vengeance, mais sur la préservation de la vie et la reconstruction du lien social.
« À l’inverse, la justice réparatrice, en privilégiant la responsabilisation, la réconciliation et la réparation du préjudice, propose une approche plus humaine et durable. Elle s’inscrit dans la continuité de la philosophie abolitionniste, en cherchant à réhabiliter l’individu et à lui offrir une seconde chance, plutôt que de l’exclure définitivement.
« La Commission des droits de l’homme œuvre pour promouvoir une politique pénale axée sur la réhabilitation, à travers l’intégration de programmes communautaires, en collaboration avec les ONG et en partenariat avec des employeurs prêts à offrir une seconde chance aux détenus.
« Nous travaillons notamment, à travers notre newsletter, à la sensibilisation à l’importance d’offrir une seconde chance aux anciens détenus. Trop souvent, les personnes incarcérées sont stigmatisées et rejetées une fois leur peine purgée, ce qui freine leur réinsertion et augmente le risque de récidive.
« D’après les données récentes, le taux de récidive carcérale à Maurice est estimé à 73 % en 2024.
« Au-delà des tragédies individuelles, ce taux alarmant traduit une réalité sociale préoccupante : l’insécurité grandissante qui pèse sur la population. Les citoyens vivent dans la crainte constante d’être victimes d’actes criminels, ce qui les pousse à consacrer une grande partie de leur énergie et de leurs ressources à protéger leurs proches, plutôt qu’à contribuer sereinement au développement du pays.
« Cette peur quotidienne érode le tissu social et crée une distance entre les citoyens. Il est donc crucial que la société mauricienne comprenne que donner une seconde chance aux anciens détenus ne leur profite pas seulement à eux : c’est un investissement dans notre sécurité collective, notre paix sociale et notre avenir commun.
« En sensibilisant la société à la valeur du pardon, à la nécessité d’un accompagnement, d’une formation professionnelle et d’un nouveau regard sur les anciens détenus, ceux-ci peuvent contribuer positivement à la communauté tout en favorisant la cohésion sociale et la sécurité collective.
« Pour moi, ce qui résume le mieux la nécessité d’abolir la peine de mort, c’est cette citation de Robert Badinter, artisan de son abolition en France :
« La peine de mort est contraire à ce que l’humanité a de plus noble : le refus de désespérer de l’homme. »
—
XAVIER-LUC DUVAL :

« La peine de mort n’a jamais été une solution »
L’ancien vice-Premier ministre et leader du PMSD, Xavier-Luc Duval, revient sur les circonstances de l’abolition de la peine de mort en 1995. Il explique pourquoi, selon lui, son rétablissement n’apporterait rien à la lutte contre la criminalité.
La peine de mort a été abolie à Maurice en 1995. Dans quelles circonstances cette décision a-t-elle été prise ?
L’abolition de la peine de mort a toujours été une revendication majeure du PMSD. Sir Gaëtan Duval en avait fait son cheval de bataille. Nous nous souvenons de la confrontation entre lui et sir Harold Walter, fervent défenseur de la peine capitale, lors des débats parlementaires sur une motion réclamant l’abolition de la peine de mort en 1972. Cette motion n’avait toutefois jamais été mise aux voix.
En 1995, après l’élection partielle de Rose-Hill, le PMSD était en pourparlers avec le MSM pour rejoindre le gouvernement. Sir Gaëtan Duval et moi-même étions les principaux négociateurs. Mon père avait alors posé comme condition essentielle à toute alliance l’abolition de la peine capitale. C’était une position de principe, profondément ancrée dans les valeurs du parti. Sir Gaëtan n’avait pas voulu rater l’occasion de faire avancer une cause aussi fondamentale. Depuis, il n’y a pas eu de progrès sur ce dossier.
Sir Anerood Jugnauth a accepté cette demande, malgré certaines réticences au sein même de son gouvernement. À l’époque, j’étais nommé ministre du Tourisme et de l’Industrie, et Maurice Rault est devenu Attorney General. C’est lui qui a préparé et présenté les textes de loi sur l’abolition de la peine de mort et sur la lutte contre le blanchiment d’argent – deux réformes importantes. Certains ministres refusaient de voter, mais Anerood Jugnauth a tenu parole. L’ancien chef juge sir Maurice Rault était foncièrement contre la peine capitale. Il disait toujours qu’un État qui tue se mutile.
Pourquoi dites-vous que cette mesure n’a rien à voir avec la question du “Law and Order” ?
Parce que la sécurité publique ne dépend pas de l’existence ou non de la peine de mort. Elle dépend surtout de la qualité du travail policier : la formation, les équipements, la motivation et la rigueur des enquêtes. Ce sont ces éléments qui dissuadent les criminels, pas la menace d’une exécution.
Regardez la situation actuelle : Maurice a parmi les peines les plus sévères de la région en matière de trafic de drogue, et pourtant le problème persiste. Cela prouve bien que la sévérité des lois ne suffit pas. Ce qui fait défaut, c’est la capacité à appréhender les coupables et à les traduire rapidement devant la justice.
Malheureusement, dans tous les domaines, on constate un laisser-aller général au niveau du pays, malgré ce que disent les membres du nouveau gouvernement. Il suffit de voir la salubrité publique, notamment dans nos régions côtières, en particulier dans le nord du pays. Alors qu’on parle de l’île-aux-Bénitiers où l’ordre semble avoir été rétabli, ce n’est pas le cas dans de nombreuses autres îles, dont l’île d’Ambre. Ceux qui l’ont visitée durant le week-end disent avoir été dégoûtés par la situation.
Certains affirment que la réintroduction de la peine de mort pourrait freiner les crimes les plus odieux, notamment ceux contre les enfants. Que leur répondez-vous ?
Je comprends ces réactions. Quand la société est choquée par un crime abominable, il y a une émotion collective, une réaction épidermique. Mais cela ne veut pas dire que la solution réside dans la peine capitale. Prenons la violence domestique : il faut une police réactive, des voisins qui osent signaler les cas, des écoles attentives aux signes d’alerte, un ministère de la Famille plus efficace. C’est un travail collectif de prévention, pas une réponse punitive extrême.
Et puis, il faut aussi se souvenir qu’il y a des erreurs judiciaires. La peine de mort, elle, est irréversible. On ne revient pas sur une exécution injuste.
Vous évoquez souvent les lenteurs du système judiciaire. En quoi cela aggrave-t-il la situation ?
C’est un point central. Lors d’une PNQ, quand j’étais leader de l’opposition, j’avais souligné que sur 122 cas de trafic ou d’importation de drogue, moins de cinq avaient été portés devant la cour. Les autres faisaient l’objet d’enquêtes interminables, parfois de plus de cinq ans.
Quand un trafiquant sait qu’il ne sera jugé que dans dix ans, il accepte de prendre des risques. Il sait qu’en dix ans, beaucoup de choses peuvent changer. Ce n’est pas la peur de la potence qui le retiendra, mais la certitude d’être arrêté, jugé et condamné rapidement. Voilà pourquoi je dis que la justice rapide est plus efficace que la peine de mort.
Vous considérez donc que la justice ne doit pas être uniquement punitive ?
Exactement. La justice doit protéger la société, mais aussi corriger et prévenir. Si tout le monde dans un quartier sait où et par qui la drogue circule, mais que rien ne se passe, ce n’est pas une question de loi trop douce. C’est une question de volonté et d’efficacité du système.
La peine de mort pourrait-elle un jour revenir à Maurice ?
Techniquement, oui. Elle a été abolie dans les textes ordinaires, pas dans la Constitution. Cela veut dire qu’un gouvernement pourrait, par simple majorité, voter une loi pour la réintroduire. Mais ce serait une erreur historique. Le monde évolue, les sociétés mûrissent. Revenir en arrière sur une question aussi fondamentale serait un pas dans la mauvaise direction.
L’amendement de la Constitution est donc essentiel ?
Il faut savoir que l’article 4 de la Constitution stipule que « nul individu ne peut être intentionnellement privé de la vie, sauf en exécution d’une décision de justice le condamnant pour crime ». Il est donc évident que, malgré la suspension de la peine de mort en 1995, la Constitution l’autorise encore dans certaines circonstances. Il suffirait de présenter une nouvelle législation adoptée par une majorité simple.
Il est intéressant de noter que le nombre de pays ayant aboli la peine de mort est en hausse. En 2023, plus de 170 pays ont aboli la peine de mort ou instauré un moratoire. En France, la peine de mort a été abolie en 1981 : on estime aujourd’hui qu’elle est incompatible avec les valeurs de justice moderne et la promotion des droits humains.
Vinod Boolell (juriste et ancien juge)
« La peine de mort est une bêtise infinie,
une cruauté absolue »
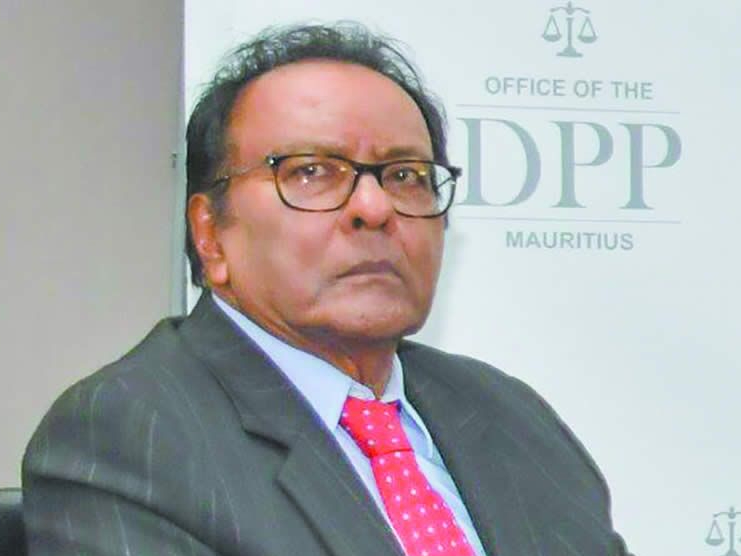
Vous avez participé la semaine dernière à la table ronde sur la peine de mort à l’IFM. Pouvez‑vous nous rappeler les grandes lignes de votre intervention ?
J’ai voulu replacer la peine de mort dans un cadre plus large, celui de la réflexion humaine sur la justice. J’ai cité Flaubert, qui disait à Guy de Maupassant : « La Terre a des limites, mais la bêtise humaine est infinie. »
Pour moi, la peine de mort fait partie de ces bêtises infinies. C’est une idée que des sociétés éclairées auraient dû dépasser depuis longtemps. J’ai aussi évoqué des figures comme Robert Badinter ou Victor Hugo, qui ont consacré leur vie à combattre la peine capitale au nom de la dignité humaine.
Vous dites que la peine de mort a été imposée à Maurice. Que voulez‑vous dire par là ?
Historiquement, la peine de mort a été introduite par le pouvoir colonial britannique pour les crimes capitaux, principalement le meurtre et la trahison. L’empire britannique l’a imposée dans toutes ses colonies, y compris aux États‑Unis avant leur indépendance. Il y a eu pas mal d’exécutions aux États-Unis, et cela se poursuit aujourd’hui. Il y a eu plusieurs exécutions à Maurice sous le régime colonial.
Nous avons longtemps vécu sous ce régime punitif. Je me souviens encore d’un épisode tragique : en 1952, trois hommes avaient été pendus pour le meurtre de deux enfants à La- Citadelle. J’étais alors à l’école primaire. L’un d’eux, surnommé Pic‑Pac, est resté dans les mémoires. La dernière exécution coloniale a été celle de Claude Gowin, en 1961.
Puis il y a eu une pause…
Entre 1961 et 1984, plus aucune exécution n’a eu lieu. Il y avait encore des condamnations à mort, mais sir Seewoosagur Ramgoolam n’a jamais signé d’ordre d’exécution. Ce moratoire fait naître un espoir : celui d’une évolution vers l’abolition.
Mais cet espoir a été brisé en 1984, lorsque Louis Leopold Myrtille a été exécuté. Cela avait été un choc pour l’opinion publique. Je me souviens qu’un journal m’avait demandé ma réaction. J’avais répondu que, comme avocat, j’avais fait mon travail, mais que j’étais personnellement contre la peine de mort.
Et après ?
La deuxième exécution dans l’histoire de Maurice indépendante eut lieu en 1987. Eshan Nayek a été pendu, et sir Anerood Jugnauth restera le seul Premier ministre à avoir signé deux ordres d’exécution.
En 1984, il déclarait : « En tant que responsable de ce pays, nous devons nous garder de tomber dans le piège de l’hystérie. » Il était fermement pour la peine de mort. Pourtant, 11 ans plus tard, en 1995, c’est sous son gouvernement que la peine capitale a été « abolie », bien qu’en réalité juste suspendue.
Vous insistez sur le mot « suspendue ». Pourquoi ?
Parce qu’il est exact juridiquement. La peine de mort n’a pas été abolie à Maurice. Elle a simplement été suspendue le 4 août 1995. L’article 4 de la Constitution prévoit toujours qu’on peut infliger la peine capitale. Tant que cette disposition n’est pas supprimée, un gouvernement peut à tout moment rétablir la peine de mort. Et sir Anerood Jugnauth l’avait d’ailleurs dit très clairement lors des débats parlementaires : « La porte reste ouverte pour tout gouvernement à l’avenir. »
Vous parlez d’un « arrangement politique ».
Oui. La suspension de la peine de mort n’a pas été un acte moral ou philosophique. C’était une manœuvre politique. En 1995, la majorité de Jugnauth était fragile, et il avait besoin de rallier Gaëtan Duval et ses partisans. Cette alliance a permis de présenter la suspension comme une victoire humaniste, mais en réalité, il n’y a jamais eu de volonté politique ferme d’abolir la peine capitale. On a fait un compromis de circonstance.
Le pays, lui, est resté dans une zone grise : ni abolition, ni application. Lorsqu’il résume les débats, SAJ rappelait que les articles de la Constitution se rapportant à la peine de mort n’ont pas été amendés. « La porte est toujours ouverte pour tout gouvernement à l’avenir si le besoin de restaurer la peine capitale se fait sentir. »
Pourtant, la société mauricienne reste partagée. Pourquoi, selon vous ?
Parce que la peur et la colère guident souvent le débat. Nous invoquons la vengeance, ou la dissuasion. Nous disons : « Si on exécute les criminels, les autres auront peur. » Mais c’est faux.
Toutes les études sérieuses le démontrent : la peine de mort n’a pas d’effet dissuasif. Ceux qui commettent des crimes ne réfléchissent pas à long terme. Ils agissent sous l’emprise de la passion, de la drogue ou du désespoir. La menace d’une corde au cou ne les arrête pas.
Pour vous, la peine de mort est donc inutile. Mais vous dites aussi qu’elle est cruelle.
Oui. C’est une cruauté absolue. Non seulement l’acte d’exécution, mais aussi l’attente, la peur, les nuits dans le couloir de la mort. Imaginez un condamné qui apprend qu’il sera pendu le lendemain. Il passe sa dernière nuit avec la certitude de mourir. Cette torture psychologique est inhumaine. Ce n’est pas la justice, c’est une vengeance institutionnalisée.
Vous avez connu ces moments de près, comme juge. Comment avez‑vous vécu cela ?
J’ai eu à prononcer une condamnation à mort dans une affaire de trafic de drogue. C’est un moment d’une intensité terrible. La salle est silencieuse, le juge doit prononcer la sentence en expliquant à l’accusé qu’il sera pendu jusqu’à ce que mort s’ensuive. Avant de parler, on lui demande s’il a quelque chose à dire. Il répond souvent : « Je suis innocent. » Et on sait qu’on va envoyer un être humain à la mort. C’est un poids difficile à porter, même pour un magistrat. Ce n’est pas seulement dur pour l’accusé ou l’avocat; c’est aussi lourd pour le juge.
Certains disent que les familles des victimes ont besoin de voir la justice « faite ». Que leur répondez‑vous ?
Je comprends leur douleur, mais je ne suis pas convaincu que l’exécution d’un meurtrier apporte la paix. Peut‑être un sentiment d’apaisement momentané, mais la mort d’un homme n’efface pas la souffrance. Elle ne répare rien. Beaucoup de familles, après coup, se demandent si c’était vraiment nécessaire. Et puis, la justice humaine n’est pas infaillible. Une erreur judiciaire, dans ce cas, est irréversible.
Alors quelle est, selon vous, la vraie solution ?
Il faut travailler sur les causes profondes de la violence. L’éducation d’abord. Expliquer aux jeunes, dès l’école primaire, ce qu’est la violence et ce qu’elle provoque. Ensuite, la pauvreté. La misère crée la colère, le désespoir, et parfois la criminalité. Quand on n’a rien à manger, on finit par tout tenter. Il faut offrir aux jeunes des perspectives, des modèles positifs, des opportunités d’emploi. Et bien sûr, il faut lutter sérieusement contre la drogue, qui alimente tant de crimes aujourd’hui.
Mais la criminalité ne cesse d’augmenter. Beaucoup pensent qu’il faut des mesures plus dures.
Je comprends ce réflexe. Mais la sévérité ne doit pas se confondre avec la brutalité. Il faut que la justice reste humaine. Le rôle de l’État n’est pas de se venger, mais de protéger. Si on croit qu’on va résoudre la violence par la pendaison, on se trompe. Regardez : en 1987, nous avons exécuté Nayek. Est‑ce que la criminalité a diminué après ? Non. Aujourd’hui encore, malgré la suspension, les crimes violents existent. La réponse doit être structurelle, pas symbolique.
Vous soulignez aussi que la peine de mort reste juridiquement possible. Est‑ce une menace réelle ?
Oui, car la porte reste ouverte. Aucun gouvernement n’a eu le courage d’effacer la disposition constitutionnelle qui permet la peine capitale. Ni Ramgoolam, ni Jugnauth fils. Aucun programme électoral n’en parle. C’est comme un tabou. Peut‑être par peur de choquer l’opinion publique. Mais un pays qui prétend défendre les droits humains ne peut pas garder une telle clause en réserve. Il faut la supprimer.
Par ailleurs, le statut abolitionniste du pays demeure stratégiquement contingent. Maurice n’est pas un Etat partie au deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), dont l’acte premier se lit comme suit : « Aucune personne relevant de la juridiction d’un Etat partie au présent protocole ne sera exécutée. » La ratification de ce protocole obligerait juridiquement Maurice, en vertu du droit international, à interdire définitivement les exécutions.
D’où l’importance du débat sur la peine de mort ?
Exactement. La peine de mort est un échec moral. Elle ne dissuade pas, elle ne répare pas; elle détruit deux vies au lieu d’une. La société doit éduquer, prévenir, offrir des alternatives. Si nous voulons être un État de droit moderne, il faut tourner définitivement la page de la pendaison. C’est pourquoi le débat public doit se poursuivre.



