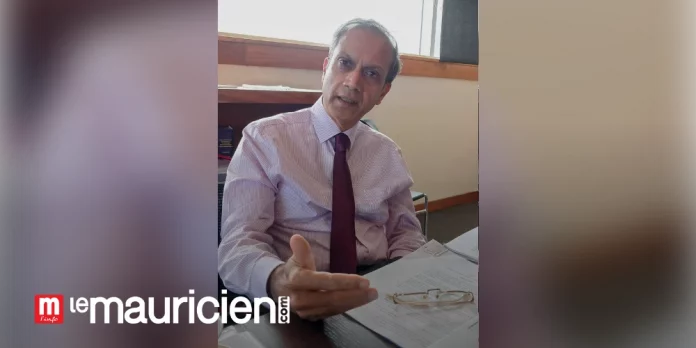Notre invité de ce dimanche est le Directeur des Poursuites Publiques, Me Rashid Ahmine, qui a répondu à nos questions vendredi matin.
l On pensait que depuis que le gouvernement a redonné au poste que vous occupez son indépendance prévue par la Constitution, les rapports entre les Casernes centrales et votre bureau s’étaient normalisés. Or, ce qui vient de se passer dans le cadre de l’affaire Hossenbacus semble démontrer le contraire. Donc, le tug of war CP/DPP existe toujours ?
— Pas du tout ! On ne peut pas comparer la situation qui prévalait auparavant et celle de maintenant. Je peux vous dire que depuis que le nouveau CP a été nommé, il est venu me voir deux fois et que nous nous parlons au téléphone en cas de besoin. L’épisode dont vous parlez est survenu parce que mon bureau n’a pas disposé de toutes les informations nécessaires de la police pour prendre une décision appropriée. Ce qui compte, au final, c’est que la bonne décision a été prise.
l Peut-on parler de rétention d’information ?
— Quand la Bail Act a été récemment amendée, il a été décidé, avec raison, que quand la police décide de détenir une personne, elle doit obtenir l’autorisation du bureau du DPP. Mais s’il n’y a pas d’objection à la remise en liberté de quelqu’un, elle n’a pas besoin de consulter le bureau du DPP. Pour simplifier le travail, nous avons envoyé à la police un formulaire à remplir avec des informations nous permettant de prendre une décision. Le CP a envoyé ce formulaire à tous les policiers concernés. Dans le cas qui nous occupe, toutes les informations ne nous ont pas été données. Je ne peux dire si c’était délibéré ou si c’était par négligence. C’est grave dans la mesure où c’est l’enquêteur qui remplit le formulaire, doit faire vérifier par son supérieur qui le signe avant de nous l’envoyer. Est-ce que cela a été fait ? Je ne sais pas. Puisque nous parlons d’accidents mortels, je voudrais ajouter qu’il y a eu, parmi d’autres, deux cas fatals en novembre. Dans le premier, qui a eu lieu au Morne, une jeune maman a perdu la vie. Je tiens à faire ressortir que dans ce cas, et contrairement à certaines informations, mon bureau a objecté à la libération du chauffeur qui est actuellement admis à l’hôpital. Dans le deuxième, dans lequel un enfant est décédé, le dossier n’a jamais été envoyé au DPP par la police pour une décision.
l Vous venez de me dire que les relations entre nouveau CP-DPP ne sont plus les mêmes. Mais l’ex-CP Dip vient de vous attaquer directement dans une affaire devant la Cour suprême…
— Il va sans dire que je ne ferai aucun commentaire sur cette affaire, comme vous venez de le dire, est devant la Cour suprême.
l Est-ce que le Police and Criminal Justice Bill annoncé va vraiment changer fondamentalement la procédure pénale ?
— Cette nouvelle législation va apporter beaucoup de changements positifs. Il faut savoir que cette loi a été déjà rédigée dans son ensemble depuis 2011, 2012, 2013 par le juriste britannique, qui a été ensuite anobli, sir Rivling KC. Le projet de loi présenté cette année est, dans sa forme, presque pareil au texte d’origine, avec quelques changements importants. C’est une loi qui aurait dû avoir été votée et appliquée depuis longtemps.
l Pour quelle raison est-ce que ce texte, préparé il y a maintenant treize ans, n’a pas été voté et mis en application ?
— C’est une question qu’il faudrait poser aux précédents gouvernements. D’après ce que j’ai entendu dire en 2013 ou 2014, le DPP de l’époque avait des suggestions à faire. Et puis sont arrivées les élections générales de 2014 et le nouveau gouvernement a décidé de ne pas aller de l’avant avec cette loi. L’un des principaux points positifs de cette loi repose sur le fait que, désormais, on ne peut pas arrêter quelqu’un seulement sur la base d’une simple allégation, ce qui est arrivé bien souvent dans le passé. Il faudra désormais que la police fasse une enquête sur l’allégation avant de procéder à une arrestation. C’est une grande avancée, tout comme l’abolition de la charge provisoire, et d’autres sauvegardes dans des cas d’arrestation. Il faudra par exemple que la police justifie devant un magistrat les raisons d’une éventuelle arrestation prolongée pour l’obtenir. Tout cela pour respecter la section 5 de la Constitution qui garantit les libertés individuelles.
l Est-ce que l’application de cette nouvelle loi ne risque pas de se heurter aux pratiques en vigueur dans la police, depuis des années ?
— C’est possible, parce que des policiers ont été habitués à fonctionner d’une certaine manière. C’est pourquoi qu’avant que la nouvelle loi ne soit appliquée, il faudra s’embarquer dans une vraie campagne d’explication et de sensibilisation, pas seulement au niveau de la police, mais également de toutes les law enforcement agencies. Cette nouvelle législation les poussera au préalable à mener une enquête et rassembler des preuves solides avant d’envisager une arrestation, ce qui, malheureusement, n’est pas le cas actuellement. Pour ce faire, il va falloir que le personnel de ces agences comprenne bien la loi, son esprit et dispose de ressources nécessaires pour l’appliquer.
l Justement, l’application de cette nouvelle loi va nécessiter beaucoup de nouvelles ressources. Est-ce qu’elles sont disponibles ?
— Si nous voulons atteindre les objectifs fixés, il faudra nous donner les ressources nécessaires pour le faire.
l Certains redoutent que la future nouvelle loi diminue les pouvoirs de la police dans la lutte contre le banditisme et la lutte contre les trafics de toutes sortes…
— Je ne partage pas cette opinion. Je ne pense pas que la nouvelle loi diminue les pouvoirs et capacités de la police à mener des enquêtes, au contraire, elle va l’aider à le faire de manière beaucoup plus efficace en respectant les droits du suspect. Ce qui va changer, c’est la manière de le faire. La finalité d’une enquête, c’est d’amener quelqu’un qui a commis un délit à répondre de son acte devant une cour de justice. La méthodologie de l’enquête reste la même, mais elle devra être faite en respectant les droits du suspect, en ne lui causant pas préjudice en l’arrêtant sans raison valable ou en le maintenant en détention pendant des mois et des années sans charges formelles.
l Vous avez récemment déclaré que la charge provisoire n’existe pas dans la loi à Maurice. Comment est-ce qu’un pays de droit a pu utiliser ce que vous avez qualifié de judge made law ?
— Le concept de la charge provisoire n’existe pas dans aucun de nos textes de loi. Quand la police présente un suspect devant un juge ou un magistrat après son arrestation, il doit lui donner les raisons de la demande d’arrestation. Pour ce faire, elle présente un document pour décrire le délit dont le suspect est soupçonné. On l’a appelé charge provisoire et c’est devenu une pratique courante. Par la suite, il y a eu des cas qui ont été contestés pour diverses raisons devant les cours de justice et les juges ont eu l’occasion de se prononcer sur la validité de la charge provisoire. Ils ont, avec raison, décidé qu’il n’y avait rien de mauvais dans ce qui était devenu une pratique. C’est donc le judiciaire qui a donné son support à cette pratique qui a été acceptée pendant des décennies. Le vrai problème est de l’utiliser pour faire des abus. La nouvelle loi supprime cette pratique et encourage la police à venir devant une cour avec une charge formelle.
l Est-ce que les personnes qui ont été « victimes » des charges provisoires rayées peuvent demander réparation ?
— Si elles peuvent prouver qu’une faute et des préjudices ont été commis à leur encontre, elles peuvent demander réparation, en tenant compte du fait qu’il y a une limite de temps à respecter pour ce genre d’action contre L’État.
l Depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement, la Financial Crimes Commission multiplie les enquêtes et des arrestations très médiatisées. Combien de ces enquêtes ont été complétées et envoyées à votre bureau pour des poursuites ?
— Si vous parlez des affaires rapportées dans la presse, les high profile cases très, très peu d’entre elles sont arrivées au bureau du DPP.
l Pour quelle raison ?
— Ce n’est pas à moi de répondre à cette question.
l On commence à se demander si on ne va se retrouver dans une situation connue, où ces cases seront rayés pour insuffisance de preuves ou vice de forme quand ils arriveront en cour…
— À ce stade, on ne peut savoir s’il y aura aboutissement légal ou pas de ces cases. Il faut que nous soyons en présence de ces dossiers pour déterminer s’ils contiennent suffisamment de preuves pour aller devant une cour. C’est pour cette raison que j’ai déjà dit que le bureau du DPP doit être impliqué dans ces enquêtes à un stade antérieur avant qu’elles ne soient bouclées. L’implication d’un procureur dans une enquête n’équivaut pas nécessairement qu’il va mener ou diriger l’enquête comme certains le pensent, de manière erronée. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai demandé une coopération entre les enquêteurs des agences et mon bureau.
l Pourquoi est-ce que cette coopération, qui semble tout à fait logique, n’existe pas ?
— Parce que, selon la loi, ce sont les agences qui font les enquêtes et que le mandat du bureau du DPP est d’engager des poursuites à partir de leurs dossiers. Si la loi demande une coopération entre nos institutions, elle ne dépendra plus des vœux ou souhaits des enquêteurs et deviendra une obligation. C’est d’ailleurs la pratique dans d’autres pays, qui ont inclus des provisions de la section 72 de leur Constitution, similaire à la nôtre, qui régit le bureau du DPP. Certains pensent que si notre bureau est impliqué dans une enquête, cela pourrait donner lieu à un conflit d’intérêts, on pourrait dire que nous sommes à la fois juge et partie. Il ne s’agit pas de diriger ou d’intervenir dans une enquête, mais simplement d’être informé de son déroulement pour donner des indications, une direction pour respecter les éléments en droit nécessaires pour présenter un dossier solide devant une cour de justice.
l Est-ce qu’il arrive souvent que les dossiers soumis à votre bureau soient, légalement, mal ficelés ?
— Absolument, et il y en a beaucoup dans lesquels nous devons demander un complément d’enquête. Cela peut arriver et retarde d’autant plus la procédure, parce que le dossier est renvoyé à l’enquêteur pour être revu sur certains points. Si notre bureau avait été impliqué en amont, on aurait pu éviter certaines erreurs. The Police & Criminal Justice Bill va aider en ce sens et instaurer une nouvelle culture, une nouvelle façon d’enquêter, ce qui fait qu’il est dans l’intérêt des enquêteurs de travailler de concert avec le bureau du DPP.
l Vous avez dit que très, très peu des high profile cases de la FCC sont arrivés à votre bureau…
— Je précise jusqu’à maintenant.
l Si tous ces cas étaient soumis à votre bureau, disposez-vous des ressources humaines adéquates pour les traiter rapidement ?
— Ma réponse est oui, mais nous aurons besoin, à long terme, de ressources additionnelles.
l Êtes-vous surpris par le nombre d’avocats engagés dans les high profile cases du moment ?
— C’est le droit constitutionnel de tout suspect d’avoir recours aux services du nombre d’avocats qu’il souhaite, s’il en a les moyens.
l Donc, fondamentalement, obtenir la justice est une question de moyens : plus le suspect en dispose, mieux il sera défendu…
— Je pourrais vous dire que la même situation existe dans d’autres secteurs, comme la médecine, où il faut avoir les moyens pour faire appel aux meilleurs spécialistes. Il faut que l’état donne aux institutions qui luttent contre la criminalité les ressources nécessaires pour contrer la défense et obtenir des résultats.
l En parlant de moyens… la lutte contre les trafiquants de drogue doit être LA priorité nationale. Quelqu’un vient de me dire que plus on fait des saisies médiatisées, plus de drogues semble entrer dans le pays. Avez-vous le sentiment que Maurice dispose des moyens nécessaires pour mener ce combat ?
— Il y a encore beaucoup d’efforts à faire dans ce domaine. Il y a plusieurs façons de combattre la drogue : l’éducation, la sensibilisation, la réhabilitation et la répression. On peut avoir le sentiment que, jusqu’à maintenant, nous n’avons pas atteint les objectifs fixés parce que le nombre de drogués est visiblement en augmentation, même si je n’ai pas consulté les statistiques précises sur leur nombre. En ce qui concerne la répression, je vais redire qu’aussi longtemps qu’on ne mettra pas la main sur les commanditaires, le problème restera entier. Les saisies de drogue, aussi spectaculaires qu’elles puissent être, ne mettent pas fin au trafic, puisque les commanditaires sont en liberté et continuent leur… commerce !
l Pourquoi est-ce qu’on n’arrive pas à mettre la main sur les commanditaires ?
— Premièrement, parce que les enquêteurs n’ont pas le mindset to go extra miles, ils se contentent souvent de s’arrêter à la mule. Cela dit, il faut souligner qu’il existe aussi un manque de ressources modernes pour leur permettre d’aller plus loin. Lors de mon dernier entretien avec le CP, il m’a informé qu’il comptait entreprendre quelque chose dans cette direction. Attendons voir.
l Que pensez-vous de la création annoncée de la National Crime Agency qui va regrouper les agences qui luttent contre le crime organisé ?
— C’est une très bonne idée, puisque ces agences vont avoir accès à des expertises dont elles ne disposent pas actuellement. Il faudrait également que cette nouvelle institution ne se limite pas aux crimes financiers et au blanchiment d’argent, mais se penche aussi sur les cold cases que la police n’a pas réussi à élucider. Je pense que cette institution devra être basée sur le modèle mixte Britannique-sud-africain, qui s’attaque aussi aux homicides et aux commanditaires du trafic de drogue. C’est une bonne chose aussi, parce que, souvent, les crimes financiers dépassent les limites de Maurice et se perdent dans d’autres juridictions. Il faut donc des experts avec de la compétence et de l’expérience pour diriger cette agence.
l Et là vous touchez à un point qui va sûrement provoquer un débat : faut-il ou non confier la direction de cette future NCA à un étranger ?
— Il faut voir la réalité : il y a des affaires que la police n’a pas pu résoudre ; dans le trafic de drogue, nous n’arrivons pas à toucher aux commanditaires ; au niveau des crimes financiers, dans beaucoup des cas la FCC n’arrive pas toujours à follow the money dans d’autres juridictions. On n’arrive toujours pas à percer les structures légales complexes mises en place pour blanchir les produits du crime. Est-ce que ce ne sont pas des raisons suffisantes pour dire que si nous ne disposons pas de l’expertise nécessaire de haut niveau, il faut aller la chercher ailleurs ? Cela dit, je souhaite que la nouvelle agence ne soit pas toujours dirigée par un étranger et qu’à terme un Mauricien formé en prenne la direction. Les étrangers devront travailler de pair avec les enquêteurs locaux. On ne va pas remplacer les locaux, et d’ailleurs, il y en a beaucoup qui sont très compétents, que se soit au niveau de la police ou de la FCC.
l Vous savez aussi bien que moi qu’il existe à Maurice, surtout dans les institutions gouvernementales, une forte résistance au changement et que cette nouvelle agence va remettre en question des manières de faire qui datent de décennies…
— Nous sommes en 2025 et il est temps de faire un bilan de ce que nous avons atteint au niveau de la justice et de la criminalité. Si nous constatons que nous n’avons pas complètement réussi et qu’il y a des manquements, il faut mettre de côté nos ego et nos préjugés, et nous focaliser sur les résultats. La réflexion du gouvernement vers une National Crime Agency et un National Prosecution Service aurait dû avoir été faite depuis longtemps. Il faut soutenir ces initiatives pour produire des résultats et pour que les Mauriciens retrouvent confiance dans la justice de leur pays. Comme vous l’avez mentionné, beaucoup de Mauriciens se disent que, souvent, les arrestations spectaculaires n’aboutissent pas. Il faut que les Mauriciens se disent que les agences chargées de combattre le crime sous toutes ses formes font bien leur travail et que ceux qui ont violé la loi — qu’ils soient ou pas représentés par un panel d’avocats — seront traduits en justice et condamnés.
l Vous l’avez mentionné à plusieurs reprises : il faut davantage de ressources humaines pour remplir votre mandat. Où allez-vous la recruter ?
— Tout d’abord, laissez-moi vous dire que la formation continue est très importante. Je vais recommander au gouvernement avec force la création d’une ODPP Prosecution Training Academy pour engager un processus de formation continue de nos procureurs dans beaucoup de domaines, dont la cybercriminalité. Pour répondre à votre question, dans un premier temps, je pense que si la FCC ne fera plus de poursuites, il faudrait un redéploiement des avocats qui y travaillent actuellement vers mon bureau. Il faudra, après, des recrutements additionnels. Mais il faut aussi commencer à réfléchir sur les moyens de retenir les avocats compétents qui font leur travail avec beaucoup de passion et rigueur à mon bureau. Un avocat qui débute sa carrière à la FCC et à la MRA touche trois fois plus qu’un avocat qui travaille au bureau de l’Attorney General, du DPP ou à la magistrature. L’ironie est que, souvent, les enquêteurs et les avocats des agences citées viennent demander conseil à notre bureau. Il faut améliorer les conditions d’emploi de ces avocats pour qu’ils restent au service du pays au lieu d’accepter des propositions du privé ou de l’étranger. Il faut sortir en dehors du régime du PRB. On attend des résultats, mais souvent, on oublie les moyens. Allez voir comment les choses se passent dans d’autres juridictions au niveau de bureau du DPP et vous allez tout comprendre. Il faut retenir les jeunes qui ont des capacités en leur offrant l’occasion de s’épanouir, de rise and shine.
l Que souhaitez-vous dire pour conclure cette interview ?
— Que nous allons bientôt publier un rapport sur le fonctionnement de notre bureau et des recommandations pour l’améliorer. Ce rapport, le premier entrepris sur le bureau du DPP depuis l’indépendance, a été réalisé par un consultant britannique mis à notre disposition très gentiment par le gouvernement britannique, à travers son haut-commissaire à Maurice. Le rapport est pratiquement prêt. Une de ses recommandations est la mise en place d’une loi-cadre pour le bureau du DPP et les amendements nécessaires à la Constitution pour renforcer le pouvoir du DPP. Je souhaite que ce rapport soit lu et ses recommandations étudiées et mises en pratique.
l Je ne suis pas sûr que vous allez vouloir répondre à la toute dernière question : est-ce que vous avez été nommé Senior Counsel ?
— Je sais que mon nom figurait sur la liste des avocats élevés au rang de Senior Counsel, mais je n’ai pas encore reçu les lettres patentes et je trouve aberrant que cela n’ait pas encore été fait. Sans vouloir entrer dans une polémique, j’aimerais dire que la loi que le Parlement vient de voter aurait dû l’avoir été depuis longtemps. Aujourd’hui, la sélection ne dépend plus d’une seule personne, mais de sept, avec la cheffe juge comme présidente, et les critères sont désormais établis. C’est un pas dans la bonne direction.