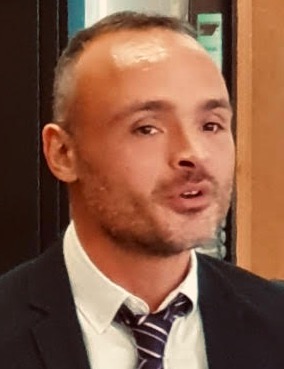Romain Vignest
La belle brochure publiée par Ramanujam Sooriamoorthy reprend à part, pour sa première partie, ici intitulée « Brasil », sa contribution au numéro spécial de décembre 2021 des Cahiers du Sertão, revue brésilienne trilingue (portugais, espagnol et français), que complète un riche essai intitulé quant à lui : « Une passion honteuse ? ». Car c’est de football qu’il est ici question, sujet guère adoubé par l’intelligentsia. De football, mais pas seulement, ou pas tout seul : si, sur la couverture, sept dessins évoquent très concrètement la réalité de ce sport, le titre est quant à lui emprunté au poème « El grito » (« Le cri ») du poète urugayen Emilio Oribe, de sorte que, appréhendée dans son unité, cette « une » semble présenter le football, celui dont toutefois il sera traité, comme une écriture, de typer mallarméen, et pour ainsi dire un genre littéraire proprement brésilien.
De fait, le long linéament verbal, caractéristique de notre auteur, qui constitue la première partie de l’ouvrage, retrace comme un ballon plumitif, ce geste, « comparable à un work in progress à la Joyce », geste à la fois épiphanique et moqueur (car repris, et pour ainsi dire confisqué, avec quelle maestria ! au maître par l’esclave), identitaire et jubilatoire, par lequel le peuple brésilien chaque fois se crée et recrée brésilien – épiphanie double d’ailleurs, puisque le football est autant celle du Brésil que le Brésil celle du football, au point que football brésilien apparaît ici et comme un stéréotype et comme une tautologie. Le football (nous n’ajouterons donc plus brésilien) se révèle ici comme un jeu au sens brechtien, un jeu également comparé au « cri de liberté, et non de douleur, du Blues dans les champs de coton, qui dit “non” à l’esclavage, qui nargue l’esclavagiste et nie l’état d’asservissement de l’esclave » – un « football samba » donc, dont on comprend dès lors qu’il soit notoirement « individuel et collectif à la fois ».
Aussi les dix sonnets qui suivent, sortes de tables fondatrices de l’épopée brésilienne, célèbrent-ils, pour six d’entre eux, et comme une ode pindarique mais dont la forme épouserait le terrain et l’écriture la balle acheminée jusqu’au but épigrammatique, quatre illustres mythiques : Garrincha, « le sublime magicien, / Tel un dieu sur le stade », « le grand » Léônidas da Silva, « artiste ensorcelant », Didi (Waldir Pereira), dont « la balle magicienne » est créatrice et poète, et Edson Arantes do Nascimenton dont « tout l’univers ne sait […] que [le] surnom », Pelé, « de loin supérieur à Agamemnon », artiste de sa propre épopée. On le voit, les héros sont ici également les poètes (au sens étymologique du titre), les faiseurs d’« un jeu presque au sens de l’illustre Mallarmé » :
Car le foot s’y écrit, aucunement programmé :
Constamment différent, toujours imprévisible,
Au point que le joueur y est comme invisible.
L’essai final, (qu’on nous passe un mot qui, étant donné notre sujet, pourrait paraître à tout le moins inapproprié !), « Une passion honteuse ? », que scandent quinze sections (quinze stations ?) part, mais pour vite en dévier, du constat d’Alexis Philonenko que les intellectuels jugeaient sa fascination pour la boxe « un peu honteuse » – quoique eux-mêmes fascinés sans oser le dire par les boxeurs. Retraçant ce qu’il appelle la brésilianisation du football, c’est-à-dire la « réécriture d’une pratique », Ramanujam Sooriamoorthy montre que « le football, qui, presque partout ailleurs, n’est, à n’en pas douter, qu’une passion médiocre, voire honteuse, au Brésil ne l’est certainement pas ». Car les Brésiliens, des Brésiliens en devenir permanent, en ce devenir que chaque match réitère et rejoue, ont, en forgeant, à travers ce qu’ils appellent o jogo bonito et cette singularité que ce sont les individualités, chaque joueur étant « une équipe à lui tout seul », qui permettent à l’équipe de se constituer et de gagner, inventé « un football tellement différent du football traditionnel que l’on s’étonne qu’on n’ait pas songé à lui trouver un autre nom ». Cette invention et cette singularité, et pour ainsi dire cette assomption brésilienne du football, tiennent à la fierté d’opprimés qui surent et savent à chaque match montrer à leurs maîtres dépossédés qu’ils sont les meilleurs dans un sport « qui s’est métamorphosé en art à la faveur de la passion d’un peuple en formation » – passion donc, mais passion fière, libératrice, jubilatoire. Et surtout, passion indéfiniment créatrice.
MORCEAU CHOISI : : … et près du Brésil (… e perto do Brasil)
Le sport le plus populaire du monde
« Ce n’est, du moins à première vue, pas le cas pour le football qui demeure le sport le plus populaire au monde, même si, depuis pas longtemps, l’on craint en Allemagne un désintérêt croissant pour ce jeu. Pratiqué, à quelques rares exceptions près, par 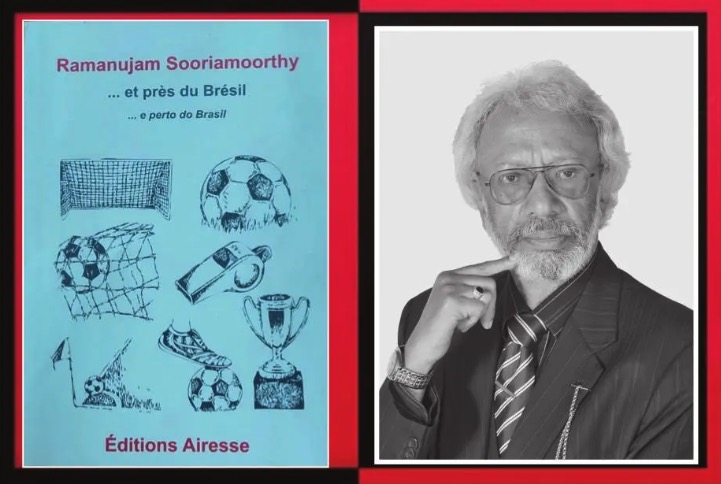 pratiquement tous les peuples, en tout cas dans presque tout pays, il fascine les joueurs autant que les spectateurs, attire les moins jeunes autant que les jeunes, suscite depuis quelque temps l’intérêt de la gent féminine elle-même avec des joueuses forçant l’admiration des hommes eux-mêmes et il n’est, de nos jours, de classe sociale qui ne s’enthousiasme pour le football. Et pourtant au départ, le football, celui qui s’est développé en Angleterre au 19ème siècle pour s’étendre aux quatre coins de la planète, n’était pratiqué que par les classes populaires, par les gens pauvres. Les riches, eux, pratiquaient l’équitation, le polo, le tennis, le cricket, et s’adonnaient à des jeux de société. Faut-il alors de cette quasi-universalisation ou, si l’on préfère, de cette mondialisation du football conclure à une certaine démocratisation de ce sport ? On serait tenté de le croire, mais il n’en est rien. Ce qui a contribué à la mondialisation du football, ce n’est pas quelque volonté de démocratie, ce serait plutôt la commercialisation du sport, du spectacle sportif surtout pour le bénéfice des investisseurs financiers.
pratiquement tous les peuples, en tout cas dans presque tout pays, il fascine les joueurs autant que les spectateurs, attire les moins jeunes autant que les jeunes, suscite depuis quelque temps l’intérêt de la gent féminine elle-même avec des joueuses forçant l’admiration des hommes eux-mêmes et il n’est, de nos jours, de classe sociale qui ne s’enthousiasme pour le football. Et pourtant au départ, le football, celui qui s’est développé en Angleterre au 19ème siècle pour s’étendre aux quatre coins de la planète, n’était pratiqué que par les classes populaires, par les gens pauvres. Les riches, eux, pratiquaient l’équitation, le polo, le tennis, le cricket, et s’adonnaient à des jeux de société. Faut-il alors de cette quasi-universalisation ou, si l’on préfère, de cette mondialisation du football conclure à une certaine démocratisation de ce sport ? On serait tenté de le croire, mais il n’en est rien. Ce qui a contribué à la mondialisation du football, ce n’est pas quelque volonté de démocratie, ce serait plutôt la commercialisation du sport, du spectacle sportif surtout pour le bénéfice des investisseurs financiers.
Le football, le Brésil
Tout lecteur aura remarqué que l’intitulé de cette partie de “… et près du brésil” ne laisse pas d’être au moins un peu ambigu : « Une passion honteuse ? ». De cet intitulé, dont le lecteur ne sait pas très bien si c’est une question qui lui est adressée, ou une exclamation, pour qu’il y réagisse, ni si c’est tout simplement, malgré tout, d’un constat qu’il s’agit décrivant peut-être un certain football, lui qui n’ignore pas que LE football, c’est encore – mais pour combien de temps encore ? – pour le monde entier, à tort ou à raison, le Brésil et le Brésil, le foot, ni si ce ne serait pas une citation, car il sait maintenant, ayant lu ce qui précède, que le titre “… et près du Brésil” est un fragment de citation, quand il ne le sût déjà pour avoir lu Emilio Oribe ou/et Borges, et il se demande très certainement, ainsi que nous l’avons fait et le faisons nous-même, ce que notre intitulé pourrait devoir à Alexis Philonenko dont beaucoup se souviennent parce qu’il a et s’est posé la question de savoir la boxe n’exerçait pas surtout sur les intellectuels, sur certains d’entre eux en tout cas « une fascination un peu honteuse », non que la pratique de la boxe elle-même (ne) soit honteuse – car ce n’est pas ce que dit Philonenko rigoureusement -, ni que la fascination qu’elle exerce ou exercerait (ne) serait honteuse – ce n’est pas non plus ce qu’il affirme -, ce qui l’intéresse, c’est la honte des intellectuels de s’être, selon eux-mêmes aussi bien que selon Philonenko qui, selon toute apparence du moins, n’a pas honte d’être fasciné et ne juge pas honteuse la fascination qui est la sienne, laissé prendre au piège d’une fascination qu’eux-mêmes trouvent honteuse, et peut-être Philonenko aussi qui, même s’il ne l’avoue pas avec un bel enthousiasme, n’a pas honte de subir « une fascination un peu honteuse », il se demande ce qu’il lui faut de tout ce que renferme plus ou moins silencieusement cet intitulé retenir. Que faut-il que retienne le lecteur ? Que cherchera-t-il, selon toute probabilité, à privilégier ?
Tout le monde – c’est le secret de Polichinelle – sait ou est convaincu de savoir, ce qui revient presque au même pour ce qui concerne les réactions et le comportement de chacun jusqu’à ce qu’il soit tiré de son aveuglement, est convaincu de savoir ce qu’est une passion aussi bien que ce qu’il en est d’une passion honteuse ? En fait, dans dix cas sur douze, chacun se trompe d’autant plus que chacun n’aura, outre qu’il n’aura entendu le point d’interrogation, compris à notre énoncé que ce qu’il lui plaît d’y voir, ce qui – hélas ! – n’a rien de bien surprenant. »