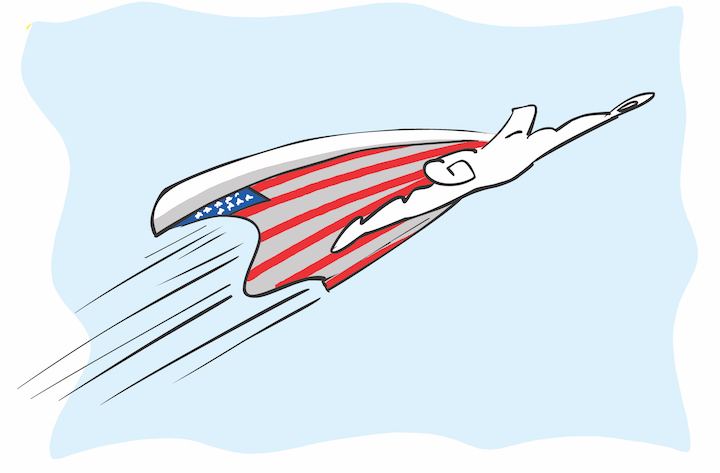FRANCK HATTENBERGER

« Donnez-moi vos pauvres, vos exténués/ Qui en rangs serrés aspirent à vivre libres/Le rebut de vos rivages surpeuplés/Envoyez-les moi, les déshérités, que la tempête m’apporte/De ma lumière, j’éclaire la porte d’or ». On peut lire cette tirade de la poétesse Emma Lazarus sur le socle de la grande dame de cuivre et de fer, accueillant à New York les démunis, les persécutés et des cohortes d’hommes ayant fui la misère, la faim et les pogroms. Elle illustre le pays du tout est possible, celui où chaque homme est accueilli et tient entre ses mains les rênes d’une meilleure vie. Si le terme apparaît pour la première fois dans une œuvre de James Truslow Adams en 1931, le concept du Rêve américain remonte à la découverte du continent. Les États-Unis ne seraient qu’une vision moderne de l’Eldorado, où celui qui ose, sue et entreprend trouvera la réussite en cadeau. À sa manière, chacun des présidents a tenté de porter, à défaut de l’incarner, une étincelle du foyer originel.
L’esprit Mayflower
L’essence de cet esprit a germé dans les cales du Mayflower, vaisseau ayant appareillé d’Angleterre en 1620, pour fonder aux Amériques une colonie durable. À son bord, des dissidents religieux jugés trop purs pour être fréquentables, sont expédiés outre-Atlantique pour rendre la terre profitable. Ces puritains rêvent d’un pays vierge et indemne, pour le défricher et ériger leur nouvelle Jérusalem. Ils sont les pères pèlerins, ceux que la mémoire de leurs descendants retiendra comme les premiers vrais Américains. Animés par une foi inébranlable, travailleurs et acharnés, ce sont des pionniers dont la moitié est décimée au cours de la première année.
Bien vite, ces nouveaux occupants et ceux qui suivent s’aperçoivent qu’ils ne sont pas les premiers et qu’un autre peuple est ici chez lui. Toutefois, à grand renfort de malice, de maladies, de fusils et de milices, les arrivants prendront le pas sur ces derniers. La terre promise leur revenant de droit divin, nul ne pourra s’y opposer, qu’il soit Iroquois ou Algonquin.
En 150 ans, les sujets de sa très Gracieuse Majesté tissent un réseau de 13 colonies prospères. Lassés de payer des impôts à un pays qui les méprise, les colons se révoltent, lèvent une armée et s’affranchissent du joug britannique en 1776. La Déclaration d’indépendance, proclamée le 4 juillet, est fortement influencée par la philosophie des Lumières, met en exergue les libertés individuelles, le droit au bonheur et se veut une portée universelle. Les accointances scellées durant la guerre d’émancipation, entre son rédacteur Thomas Jefferson et le marquis de La Fayette, auraient alors pesé sur la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, adoptée en France en 1789. On notera toutefois que ce texte, louant l’égalité entre les hommes, ne s’applique pas aux esclaves, bien trop utiles au dynamisme de ce nouveau pays, aussi vertueux qu’économe.
Un mythe accessible
À sa proclamation, le jeune État n’est qu’une maigre bande côtière, qui s’étend du Massachusetts à la Géorgie. À l’Ouest, les territoires sont infinis et semblent regorger de ressources inépuisables, offrant à chaque citoyen sa part de la terre promise. Le XIXème Siècle sera celui des guerres indiennes et de la conquête de l’Ouest. Dès lors, des familles entières s’élancent en convois de chariots à travers les Grandes Plaines. Avec une Bible dans la main et un fusil dans l’autre, elles se frottent aux Nez-Percés, aux Sioux et aux Cheyennes. Si elles survivent à cette épopée, elles franchissent les Rocheuses et débouchent sur la Californie, où le monde entier afflue déjà par bateau pour avoir sa part du gâteau. La découverte de gisements aurifères y provoque la grande ruée vers l’or et convie des milliers d’aventuriers à satisfaire. Plus que jamais, l’Amérique est en marche vers la réalité de son mythe. Dans ce pays, celui qui naît ou débarque en haillons peut vite accumuler des millions. Il ne le devra qu’à la force de son travail, de son courage et de sa volonté. Cependant, à l’instar d’une majorité de ses concitoyens, il restera probablement à croupir dans la misère, sacrifiant à la Révolution industrielle, à ses usines et ses machines, son âme et sa chair.
La couleur maîtresse
Les USA encrent leur jeune histoire d’une guerre civile et sauvage, où des armées de blancs s’entretuent pour ou contre le maintien de l’esclavage. Le Nord industrialisé, progressiste et insatiable d’ouvriers, l’emporte sur un Sud agricole, conservateur et négrier. Pourtant, il faudra encore attendre plus d’un siècle de marches et de combats, pour que les noirs accèdent légalement à leurs pleins droits. Le melting-pot à la sauce américaine a son échelle de valeurs religieuses et raciales. Il est accessible à tout un chacun, à chaque individu dit « humain », avec une préférence à peine voilée pour la matrice originelle du genre européen. Ce pays qui s’est prétendu le havre des pauvres et des pourchassés a simplement omis de préciser qui était digne du creuset. Les noirs y furent longtemps soumis aux fers, les Chinois considérés comme une peste asiatique et les Irlandais rejetés car ils étaient catholiques. Les Italiens y furent taxés de nègres macaronis et les juifs mis à l’index, car ils étaient juifs … Néanmoins, ceux qui fuient les affres de l’innommable n’ont pas la peur d’être humiliés, assurés que ces brimades sont préférables à ceux qui les ont battus ou pillés.
Locomotive économique
Vitrine d’une réussite dans le bonheur matériel, les States cultivent cette image d’Épinal et de miel. Par deux fois, ils contribuent à libérer l’Europe, d’un kaiser, des pouvoirs autocratiques et d’un führer. Projetés de fait en sauveurs du monde et en garants de ses valeurs, on omet souvent qu’ils ont avant tout agi pour leur profit, avec le capitalisme pour moteur. Dès la chute des tyrans, la locomotive économique débarque avec son train de marchandises aux goûts salés, sucrés et rêvés de l’Amérique. Le bonheur est dans la consommation, le confort et la possession.
Sur le plan intérieur, le culte de l’individualisme a autant de valeur que celui du Seigneur. Quand on invoque le Très Haut, c’est uniquement pour rendre à l’Oncle Sam la dimension spirituelle dont il s’est éloigné, sacrifiant les évangiles et ses vers sur l’autel du billet vert. Une société animée par le seul spectre de la réussite ne peut contenter tous ses enfants, l’assistance et la santé qu’ils nécessitent. Partant du principe libéral que seul le plein emploi peut juguler leur insuffisance, l’État compte sur le dynamisme de l’économie pour en offrir à tous la jouissance. L’État-providence n’est pas une notion américaine, sans quoi l’envie de se surpasser resterait vaine. Dans un pays qui fustige la misère et qui nie ses plafonds de verre, les laissés-pour-compte sont pourtant un mal nécessaire. C’est dans ce vivier bon marché qu’on pourra puiser les bras de la relance, sans trop émousser les profits et fers de lance. Mais que valent tous ces pauvres contre le rêve américain, quand un acteur, un cultivateur de cacahuètes ou le petit-fils d’un éleveur kenyan peuvent être élus présidents …
Le rêve d’aujourd’hui
Lorsque Barack Obama arrive au pouvoir en 2009, 80 millions d’Américains n’ont pour ainsi dire aucune couverture santé. La loi qu’il fera passer au forceps pour y remédier, en réduira le nombre de moitié. C’est un pas de géant, décrié par ses adversaires politiques, mais lésant enfin l’économie au profit de l’éthique. Toutefois, l’Amérique profonde préfère les héros traditionnels, musclés et prêts à dégainer, pour défendre l’Union des périls étrangers. Son successeur, le haut en couleur Donald Trump brise toutes les conventions, déchirant les accords, versant dans la compromission, et troquant la diplomatie pour l’injure et la provocation. Le pays sort de ce mandat divisé, avec des positions qui se sont radicalisées. Cette élection cristallise les passions et fait craindre des violences lors de la proclamation.
Face à Trump, ce 3 novembre 2020, le démocrate Joe Biden est une pâle figure de l’establishment, affichant surtout l’intention de poursuivre la politique d’Obama, dont il fut vice-président. Attaché au pouvoir comme un hilote l’est à son maître, Trump hurle à la fraude et tempête contre les médias accusés de traîtres. Indifférente au chant du cygne, la vox populi du peuple Yankee éjecte le rapace de son trône. Elle opte pour un adversaire, jugé plus sage et moins téméraire. Les démocrates peuvent se frotter les mains. Après avoir marqué l’histoire nationale en plaçant un Afro-Américain à la présidence, Joe Biden ouvre une voie royale pour qu’une femme entre dans la danse. En effet, l’ancien sénateur du Delaware est âgé de 78 ans et usé par une longue carrière. S’il devait jeter l’éponge avant l’échéance de son mandat, le poste reviendrait à Kamala Harris, sa colistière pour le titre suprême. Ce serait un éminent pied de nez de la gent féminine, à ce précédent locataire effrontément misogyne.
Depuis le temps des pionniers, des puritains et des aventuriers, le rêve a fait son chemin, abandonnant les illusions au profit d’un froid réalisme sans effusion. Dans ce pays, 50% des adultes n’ont plus le souhait de parvenir ou de réussir, mais simplement d’avoir une retraite assez décente pour bien vieillir. Contre la tentation au repli dans la forteresse Amérique, contre cet affront fait à la planète dans l’occultation de l’urgence climatique, contre la peur, la division, les bruits de bottes et les humiliations, ce vote est un répit. Puisse-t-il rallumer la flamme qui fit un temps rêver le monde.