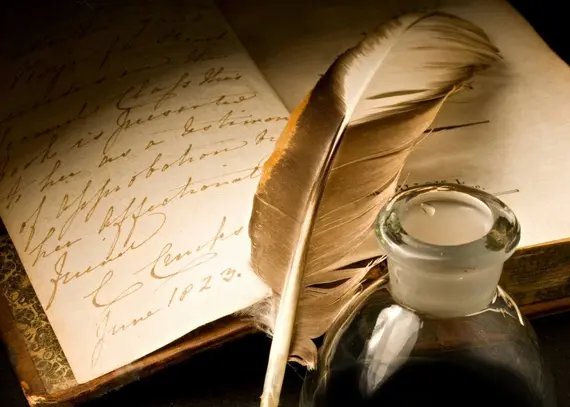« La culture, c’est l’ensemble des valeurs qui donnent un sens à la vie », affirme Léopold Sedar Senghor alors que le Mahatma Gandhi relève que « la culture d’un peuple réside dans le cœur et dans l’âme de ses citoyens ». C’est en gardant en tête l’importance de la culture dans un pays que Le Mauricien a rebondi cette semaine sur le Prix Jean-Fanchette pour faire le point s avec Issa Asgarally. Il estime que la démocratisation de l’accès à la culture doit être le premier objectif d’une politique culturelle digne de ce nom à Maurice.
…
Amarnath Hosany lauréat du Prix Jean Fanchette
« L’écriture est une façon de dénoncer sans moraliser »
Qu’est-ce que cela vous fait d’être lauréat du Prix Jean Fanchette ?
C’est un grand honneur d’être parmi les lauréats de ce prix. Je viens tout juste de me lancer dans l’écriture de romans. Mon premier manuscrit avait obtenu une mention du jury lors de la dernière édition, et le second, que j’ai soumis cette année, a été primé. C’est une belle surprise, car il y a beaucoup de participants et de talents à Maurice. Ce qui manque, c’est surtout une plateforme pour les rendre visibles. Il faut encourager les jeunes auteurs et inciter les institutions à jouer leur rôle afin que d’autres voix puissent émerger.
Ce prix va-t-il changer votre rapport à l’écriture ?
Certainement. Cela va m’encourager à continuer dans cette voie, à écrire d’autres romans. Jusqu’ici, j’étais surtout dans la littérature jeunesse. Recevoir un prix pour un roman adulte, c’est un signe fort : cela me pousse à persévérer dans l’écriture romanesque. Ce prix vient renforcer une passion déjà présente, il lui donne un nouvel élan.
Vous avez déjà été récompensé à l’étranger…
Oui, j’ai reçu le Prix Saint-Exupéry et le Prix du Livre insulaire, tous deux en France, pour mes ouvrages de littérature jeunesse. Mais le Prix Jean Fanchette a une résonance particulière : c’est un prix mauricien, enraciné dans notre culture. Il a une valeur symbolique forte pour moi.
Parlez-nous du roman primé, Le Clown. Qu’est-ce qui vous a inspiré ce personnage ?
Je ne pourrai pas vous donner la trame de l’histoire parce que ce n’est pas encore un livre. C’est un manuscrit qui a été soumis pour le prix Jean Fanchette. Nous essaierons de trouver un éditeur et le lancement pourra se faire à la municipalité de Beau-Bassin Rose-Hill l’année prochaine.
Ce que je peux vous dire, c’est que le clown est un être complexe. Il ne cherche pas forcément à faire rire. C’est un personnage qui cache beaucoup de choses. Ce surnom est choisi en lien avec l’enfance du protagoniste marquée par le harcèlement scolaire et le regard des autres. Il évoque cette souffrance, la stigmatisation, mais aussi la résilience.
C’est un roman qui s’adresse aux adultes et qui reflète l’image de l’île Maurice, avec ses réalités, ses tabous et l’hypocrisie de notre société.
Vous évoquez souvent le multiculturalisme et le “mauricianisme.
Oui, parce que je crois profondément en un mauricianisme réel, vécu, et pas seulement proclamé. On en parle beaucoup, mais souvent ce ne sont que des slogans. Dans la pratique, dans les institutions, la discrimination persiste. Toutes les communautés ne sont pas traitées de la même manière. Il faut le dire. L’écrivain a aussi une mission : celle de dire ce qui dérange.
Comment percevez-vous cette hypocrisie et cette discrimination en tant que romancier ?
L’hypocrisie et la discrimination sont quand même très visibles dans notre société. Peut-être que les gens qui sont indifférents voient cela tout à fait normal mais il y a des choses qui auraient dû changer. Nous parlons de société moderne mais il y a encore beaucoup de préjugés par rapport à l’autre, son appartenance ethnique, sa culture, son aspect physique…Il y a des gens qui n’arrivent pas à en parler. Malheureusement, certains les ont intégrées et pensent que c’est leur sort. Ils continuent leurs routes en l’ignorant. Mais cela ne peut pas rester ainsi. Il faut qu’il y ait un changement : c’est le rôle de la société, des forces vives, des gens qui militent pour l’égalité des chances dans la société. Cela doit tous nous interpeller.
Je pense que l’écriture, à travers la fiction permet de brosser un tableau de la société par le biais de ses personnages. C’est certes une histoire inventée mais basée sur les faits. Nous pouvons ressentir ce que vivent et ressentent les personnages s’ils sont bien caractérisés. Le lecteur s’identifie aux personnages. Et chaque personnage a un rôle clé qui fait avancer l’histoire. Il y apporte quelque chose de concret.
L’inspiration vous vient-elle d’événements récents ?
Elle vient du quotidien. Nous sommes interpellés tous les jours par ce que nous voyons, mais nous finissons souvent par l’accepter, par se taire. L’écriture me permet de transformer cette observation en parole, de poser un regard critique sur la société, sans juger.
Parlez-nous de la genèse de ce projet ?
Je suis notamment connu pour la littérature jeunesse. Le clown était un projet d’album jeunesse, pour les enfants. En relisant l’histoire, j’ai pensé que le sujet est délicat et le message fort. Je réfléchissais à comment faire passer ce message dans un langage simple pour un album jeunesse. D’autant qu’il y a beaucoup de ressentis. C’était compliqué.
Par conséquent, j’ai commencé à réfléchir à un roman en élaborant davantage sur les situations et en donnant plus d’épaisseur aux personnages. Avec la mention du jury obtenu par Les Guérisseurs lors de la dernière édition du prix Jean-Fanchette et suivant sa publication, j’ai continué à enrichir le sujet. Et j’ai soumis le manuscrit cette année.
Écrivez-vous tous les jours ?
Non, quand je le ressens mais je note tout ce que je vois, tout ce que j’entends. S’il y a un parfum ou une odeur qui me frappe, je le note. Je pense que ces éléments nourrissent l’imagination. Si nous arrivons à bien les agencer, nous pouvons bâtir des situations.
Faites-vous un travail documentaire en parallèle ?
Pas nécessairement. Je lis beaucoup aussi. Je note tout. Et je pense qu’il y a un processus qui se met en place. Un élément déclencheur au départ de chaque écriture.
Quelle différence entre un travail sur un album de jeunesse et un roman ?
Outre la longueur du texte et l’épaisseur qu’on donne aux personnages et des situations plus élaborées, un album de jeunesse, illustré, est une collaboration entre l’auteur.rice et l’illustrateur.rice avec le regard de l’éditeur. L’illustrateur s’approprie l’histoire et met beaucoup de ce qu’il ressent dans ses illustrations. C’est la même histoire vue par une autre personne alors que pour le roman, l’auteur est seul avec son histoire et ses personnages. C’est à lui de voir ce qui leur manque, de s’assurer qu’il n’y ait pas de contradiction dans la caractérisation de ses personnages.
Vous avez une longue expérience en littérature jeunesse. Où vous situez-vous aujourd’hui entre le roman et l’album jeunesse ?
Cela ne va pas changer mon regard sur la société. Le regard est le même et cela va dépendre de ce qui va déclencher l’histoire et de la caractérisation du personnage. Comme pour Le Clown, ce qui était d’abord une idée pour un album jeunesse a été transformé en roman. Ce qui est important, c’est de pouvoir s’exprimer et avoir un lectorat qui s’intéresse à ce que je fais.
Ce prix récompense plusieurs années d’efforts, non ?
Oui, c’est une forme de consécration. J’ai déjà présenté plusieurs textes : Les Papillons de Risha et Les Guérisseurs avaient obtenu des mentions spéciales lors d’éditions précédentes. Je n’écris pas pour obtenir des prix, mais pour un lectorat. Cela dit, être récompensé reste un encouragement : cela prouve qu’on s’intéresse à ce que je fais.
Quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes auteurs mauriciens ?
Je crois que les jeunes sont déjà dans une belle dynamique d’expression. Beaucoup écrivent, publient, même très jeunes. J’ai récemment rencontré trois enfants de huit ans qui ont publié et illustré leur propre livre ! C’est extraordinaire. Il faut encourager ces initiatives, créer des espaces de visibilité. Le Prix Jean Fanchette a toute sa raison d’être — et il faut que d’autres prix littéraires naissent à Maurice pour soutenir cette vitalité.
Vous avez d’autres projets de roman ?
Non. Plutôt des albums jeunesse. Je vais probablement rééditer Les Papillons de Risha, qui avait reçu le Prix Saint-Exupéry. Le livre avait été publié en France, mais peu distribué ici. Je souhaite qu’il soit accessible aux lecteurs mauriciens, via une maison d’édition locale. C’est important pour moi que mes œuvres puissent circuler sur leur terre d’origine.
…
Issa Asgarally, Coordinateur du Prix Jean-Fanchette
« La culture, un énorme chantier »
Vous êtes la cheville ouvrière derrière l’organisation du Prix Jean Fanchette. Pouvez-vous nous en parler.
Le Prix Jean-Fanchette a 33 ans ! Et cette année, nous avons organisé la 15e fois depuis 1992. La mairesse avait parlé lundi des trois objectifs du Prix Jean-Fanchette. Je voudrais revenir sur chacun de ses objectifs.
Le premier objectif qui consiste à honorer la mémoire de Jean Fanchette, psychanalyste, poète, essayiste, éditeur, est largement atteint. Car en 2025, soit plus de 33 ans après sa mort en 1992, on parle encore de lui. Le public pourra voir, au cours de cette semaine, des livres de Jean Fanchette à la Bibliothèque municipale et quelques-uns que j’ai apportés, dont Identité provisoire, son recueil le plus important, à mon avis. Sans compter deux numéros de sa revue « Two Cities », qu’il m’avait remis lors de notre dernière rencontre à Paris.
En ce qui concerne le deuxième objectif, encourager la création littéraire dans les îles de l’océan Indien (Maurice, Rodrigues, Réunion, Madagascar et les Seychelles), les faits parlent d’eux-mêmes. Depuis 1992, les quatorze éditions ont accueilli 326 textes. Sur ces 326 textes, une cinquantaine nous sont parvenus de l’Ile de La Réunion, de Rodrigues, des Seychelles, et de Madagascar. Par ailleurs, le Prix Jean-Fanchette a révélé des auteurs totalement inconnus et consacré ceux et celles qui l’étaient déjà.
Pour ce qui est du troisième objectif du Prix Jean-Fanchette, donner à lire, je tiens à souligner que la plupart des manuscrits primés ont été publiés. Comme vous le savez, la moitié de la somme allouée au Prix JF est une aide à la publication du manuscrit primé ou à l’achat d’un certain nombre d’exemplaires du livre primé pour les collèges de Beau-Bassin/Rose-Hill.
Cette année, nous avons reçu 32 textes en moins d’un mois, entre le 27 août et le 22 septembre. Et nous l’avons ouvert, comme en 2010, 2013, 2015, 2017 & 2019, à la fois aux manuscrits inédits et aux livres publiés depuis la dernière édition, pour pouvoir disposer d’un plus grand choix, puisque, vous vous en souvenez, le Prix n’a pas été attribué à 2 reprises, en 1992, sous la présidence de Michel Deguy, et en 2008, sous celle de JMG Le Clézio !
Je voudrais vous faire part ici d’une préoccupation constante du Jury du Prix Jean-Fanchette concernant les manuscrits sélectionnés, comme dans tout prix littéraire, mais non primés. En effet, il y a toujours six ou sept textes qui se dégagent du lot mais qui ne sont pas finalement choisis par le Jury. En 14 éditions, cela fait environ une centaine de textes ! C’est dommage, car ces textes, pourraient être publiés – et devraient l’être – s’ils sont revus, réécrits parfois sous la direction d’un éditeur professionnel. Nous invitons donc d’une part, les éditeurs et les fonds d’aide à la publication, à soutenir la publication de ces textes, d’autre part les auteurs à œuvrer pour que leurs textes ne tombent pas dans l’oubli.
Le Prix Jean Fanchette suffit-il pour promouvoir la littérature mauricienne ?
Le Prix Jean-Fanchette, créé par une municipalité comme une autre, n’est qu’une goutte d’eau dans le domaine culturel en général et le domaine littéraire en particulier. La culture à Maurice est un énorme chantier où certains grands travaux n’ont pas encore commencé. Par exemple, la démocratisation de l’accès à la culture, premier objectif d’une politique culturelle digne de ce nom. Voilà pourquoi la Formation pour l’Interculturel et la Paix (FIP), avec le soutien de quelques libraires, éditeurs et firmes de Maurice, a remis jusqu’ici des textes de fiction à un millier d’enfants démunis de Bambous, de Souillac, de Pointe-aux-Sables et de Rodrigues.
Que pourrons-nous faire de plus ?
Je profite de cette tribune pour rappeler l’intérêt constant de J.M.G Le Clézio pour le projet d’un bibliobus qui desservirait les banlieues de Beau-Bassin / Rose-Hill, qu’il a pu voir au cours d’une visite.
De tels projets sont d’autant plus importants que l’avenir de la lecture et du livre ne semble guère rayonnant. Déjà, l’Etude pluridisciplinaire sur l’exclusion à Maurice, que j’avais coordonnée en 1996/97, à la demande du président de la république, révélait que 70% de la population ne lisaient pas un seul livre par an. En France, à la même époque, il était de 40%, selon une enquête de Livres Hebdo. Nous avons pu avoir les chiffres en 2019, car j’ai dirigé, avec le soutien du National Arts Fund, une enquête sur les pratiques culturelles et les industries culturelles émergentes à Maurice . La bonne nouvelle, c’est que ce pourcentage de 70% a baissé sensiblement…
Ce qui importe, c’est que les gens lisent. S’ils ont recours à des tablettes numériques pour le faire, il ne faut pas s’en alarmer. Comme Robert Darnton, directeur de la Bibliothèque universitaire de Harvard, et Umberto Eco, je pense que le livre papier ne va pas disparaître. Pas de si tôt. Et que le manuscrit, le livre papier et le livre électronique vont coexister. À la question d’un journaliste lors d’une émission télévisée, « Faut-il donner une tablette ou un livre papier à un jeune ? », j’ai répondu : « Les deux. Et une tablette de chocolat ! »
C’est dans le cadre de ce combat pour le livre et la lecture que j’ai fait paraître en 2024 « Lire, une Anthologie internationale », où j’ai demandé à 17 écrivains du monde entier (Maurice, Réunion, France, Grande-Bretagne, Maroc, Tunisie, États-Unis, Inde, Chine, Japon) de raconter leur rencontre avec le livre et de plaider pour la lecture auprès des jeunes.
Nous sommes dans le complexe abritant le théâtre de Plaza qui est toujours fermé. Qu’en pensez-vous ?
Je suis profondément attaché au théâtre du Plaza. C’est dans ce théâtre que j’ai eu le privilège de suivre une représentation d’une pièce de mon frère, Azize, assis dans les coulisses, côté jardin, à l’endroit exact où tombent les rideaux, c’est-à-dire entre la scène et la salle. D’un côté, je voyais les acteurs, de l’autre, le public !
Ce soir-là, j’ai compris autant de choses sur le théâtre que ce que je trouverai plus tard au cours des études universitaires. Mais s’il faut rénover le théâtre, ce n’est pas uniquement pour le passé. L’avenir, ce serait la nomination d’un directeur de théâtre avec un Cahier des charges qui comprendrait un programme annuel avec une exigence de 50% de reprises et de 50% de créations. Et un système d’abonnement, comme au Théâtre Lucernaire Forum à Paris, pour que les diverses catégories sociales (jeunes, ouvriers, personnes du troisième âge, etc.) puissent fréquenter le Plaza, pour que ce beau théâtre ne soit pas inaccessible par le prix.
Le Prix Jean-Fanchette de la Mairie de Beau-Bassin / Rose-Hill et le projet « Livres pour tous » de la FIP ne sont que de petites constructions sur le grand chantier de la culture.
Soulignons que le président du Jury JMG a lui-même publié des livres depuis la dernière édition du prix Jean Fanchette : « Avers : Des nouvelles des indésirables » (2023) et « Identité nomade » (2024).
…
Nicolas Couronne (lauréat du prix Jean-Fanchette 2025) :
« Je dédie le prix à Constance Couronne »
Qu’est-ce que ça vous fait d’être lauréat du prix Jean-Fanchette ?
Je suis ravi. Et encore plus, parce que c’est un jury présidé par un prix Nobel de littérature, M. Jean-Marie Gustave Le Clézio. Savoir que mon manuscrit a été lu par une éminente personnalité, ça me ravit. Je dirais aussi que je ne m’y attendais pas et je suis très heureux.
S’agit-il de votre premier texte littéraire ?
Oui, c’est mon premier texte littéraire.
De quoi parle-t-il et pourquoi l’avez-vous écrit ?
Ce texte n’est pas une fiction. C’est une histoire vraie. Celle de l’esclavage. Et, si je peux me permettre, je vais vous raconter comment l’idée m’est venue. En 2018, un ami m’envoie un message sur Facebook et en cliquant dessus, je vais tomber sur la photo d’une dame africaine, en tenue victorienne. Une centenaire. Je vais être bouleversé en regardant son visage. Elle ressemblait étrangement aux parents de mon père qui vivaient à Mahébourg. Et là, quand je regarde son nom, je vois qu’elle s’appelle Constance Couronne.
Alors, mettez-vous à ma place : je vais être troublé. Quel est ce personnage ? Pourquoi elle ressemble au mien ? Et pourquoi elle est dans des habits victoriens ? Et là, ce visage-là va me faire devenir un rat des archives. Je vais aller faire des recherches, essayer de découvrir l’histoire derrière cette personne. Et elle a une histoire fascinante, une histoire vraie. C’est un pan de notre histoire qu’on ne connaît pas.
Est-ce aussi un récit familial ?
Non, c’est une histoire de notre pays qu’on devrait savoir mais ce n’est pas un récit d’historien. Le regard de mon ancêtre esclave est à la croisée de l’histoire et de la mémoire. Il s’agit aussi d’une aventure humaine. Je vais raconter dans ce livre comment je suis allé à la recherche de l’histoire de cette dame, parce que c’est une histoire qui n’est pas connue.
Elle venait de Mahébourg, elle ressemblait étrangement beaucoup aux miens : à mon oncle, à mon grand-père même à mon frère. Ça m’a fait quelque chose, déjà, de savoir qu’on a des ancêtres qui étaient esclaves. C’était comme une main tendue du passé. J’ai voulu connaître son histoire.
Nos ancêtres esclaves ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire, et malheureusement, cet aspect de notre histoire est très méconnu. Alors, la petite Constance, à huit ans, était envoyée chez une dame Maurel pour apprendre à coudre. Et, le 11 mai 1832, il y aura un drame chez la dame Maurel. En buvant une tasse de thé, elle va avoir des maux d’estomac, etc. Et la petite Constance et sa cousine Elizabeth Verloppe vont être accusées d’avoir mis un produit dans le thé de la dame Maurel. En cherchant dans les archives de Coromandel, je vais comprendre comment elle a été manipulée par une esclave qui s’appelait Bélise. Elle était une adulte et les enfants avaient peur d’elle. Avec sa cousine, elle va être emprisonnée, jugée et condamnée.
À l’âge de huit ou neuf ans, elle va être déportée. On va chercher un lieu pour l’envoyer. Il était question de Robben Island, ou encore une île où on envoyait les lépreux à l’époque (ndlr : l’île Curieuse, aux Seychelles), mais finalement, elle a été envoyée en Nouvelle-Galle du Sud (New South Wales), en Australie. Ce jugement a été très sévère, parce qu’elle a été condamnée à vie, à huit ans. Cela montre qu’on n’avait pas de considération pour un enfant esclave et on avait peur. La peur que cela puisse influencer d’autres esclaves. C’est pourquoi ils ont voulu prendre une décision forte. En posant les pieds à Sydney le 9 juillet 1834, elle devenait ainsi la plus jeune condamnée de l’histoire de l’Australie. Ce qui n’a jamais été officiellement reconnu.
Aujourd’hui, je suis heureux parce que l’ambassade australienne fait appel à moi pour raconter cette histoire, peut-être pour la célébration de l’abolition de l’esclavage.
Donc, elle a fait de la prison, mais elle a aussi pu avoir de la chance d’exercer comme domestique chez un policier et chez un magistrat. Elle s’est mariée et a eu 11 enfants. Et aujourd’hui, elle est matriarche de plus de 4 000 descendants en Australie. Je suis entré en contact avec ses descendants. Je suis allé en Australie également pour les rencontrer. Si vous tapez Constance Couronne sur YouTube, vous verrez des émissions faites sur elle à la télé.
Que représente cette histoire pour vous ?
Elle représente beaucoup. Si vous voulez, cette histoire-là débute dans un regard. Le regard de cette dame sur la photo m’avait bouleversé et j’ai l’impression que c’est elle qui m’a guidé. Qu’elle voulait que je fasse connaître son histoire. Je suis croyant, mais pas superstitieux.
Il est important aussi de souligner que d’autres Mauriciens avaient été envoyés en Nouvelle-Galle du Sud. C’est un aspect de notre histoire qu’on ne connaît pas. On ne l’a jamais vu dans des livres d’histoire. Il y a une historienne, Santilla Chingaipe, qui a écrit un livre intitulé Black convicts : How slavery shaped Australia. Elle en parle. Il y a tous les noms des Mauriciens qui ont été envoyés dans le New South Wales, en Australie.
Quel est votre statut ? Ecrivez-vous à plein temps ?
Non, je suis un ancien employé d’Air Mauritius. J’ai travaillé comme superviseur des opérations au sol pendant très longtemps, avant de prendre une retraite anticipée. Aujourd’hui, je suis le manager du collège Saint-Esprit, de Rivière-Noire.
Combien de temps a duré ce travail ?
J’ai vu cette photo-là en décembre 2018. J’ai commencé mes recherches. En 2023, je suis allé sur ses traces en Australie. Et, en mars de cette année, j’ai commencé à écrire.
Je n’étais pas au courant de l’existence du prix Jean-Fanchette. Le dernier lundi avant la date limite pour soumettre son manuscrit, un copain m’a dit pourquoi tu ne soumets pas le livre que tu as écrit pour le prix. Là, j’ai pensé que c’était une bonne idée et il m’a aidé pour l’impression et l’envoi du manuscrit. Et aujourd’hui, je suis très heureux.
Continuez-vous vos recherches et à écrire ?
C’est mon premier manuscrit. J’écris avec mon cœur ; je ne suis pas un littéraire. Je suis porté par cette histoire. Pour moi, sur la tombe de cette femme, j’ai fait un serment que son histoire soit connue à Maurice. Je n’ai pas particulièrement l’intention d’en écrire d’autres, mais j’ai envie que ce livre, l’histoire de Constance Couronne, soit connu à l’île Maurice. Je continuerai peut-être à écrire sur elle. Il y a pas mal de choses sur elle.
Vous verrez dans le livre qu’une partie de ses descendants essayent de changer son identité. Certains d’entre eux disent qu’elle était une noble, une vicomtesse, etc. C’est tout à fait faux. Quand on veut changer la transmission de l’histoire, celle de l’identité d’une esclave, on invente des choses. Une de ses descendantes est venue à Maurice. Elle a cru dans ce projet. Nous avons beaucoup partagé et elle m’avait invité en Australie.
Qui reçoit ce prix aujourd’hui ?
C’est Constance. C’était ça mon but. Je dédie le prix Jean Fanchette à Constance Couronne.
….
31