La Commission Pontificale pour la Protection des Mineur·e·s a rendu public son deuxième rapport annuel, consacré cette année à la question cruciale de la réparation. Dans la continuité de son premier rapport pilote, centré sur la « justice par la conversion », l’instance poursuit sa réflexion sur les quatre piliers de cette démarche, notamment la Vérité, la Justice, la Réparation et la Réforme institutionnelle. Le rapport 2024 met ainsi en lumière la responsabilité de l’Église dans l’accompagnement des victimes sur leur chemin de guérison, rappelant, selon les mots de son président Mgr Thibault Verny, que « la sauvegarde n’est pas séparée de la mission de l’Église : c’est la mission de l’Église ». Dre Émilie Rivet, psychologue clinicienne et membre de la Commission Pontificale pour les protections des mineur. e. s nous présente les grandes lignes de ce rapport crucial.
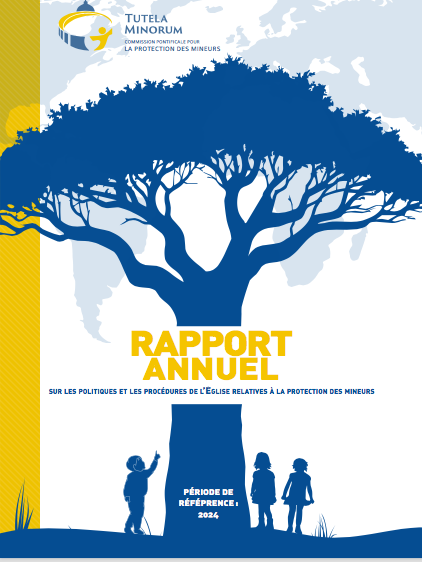 Dre Émilie Rivet explique que la Commission a bénéficié de plus d’une décennie d’enseignements issus de l’écoute directe des personnes victimes d’agressions sexuelles. Elle indique que conformément à son approche centrée sur les personnes victimes, la Commission a mis en place un groupe diversifié de personnes victimes d’agressions sexuelles au sein de l’Église, soit le « Groupe de discussion RA ». Ainsi pour ce rapport, la méthodologie de ce « Groupe de discussion RA » a été élargie à l’ensemble des quatre régions : Les Amériques, Afrique, Asie-Océanie et l’Europe.
Dre Émilie Rivet explique que la Commission a bénéficié de plus d’une décennie d’enseignements issus de l’écoute directe des personnes victimes d’agressions sexuelles. Elle indique que conformément à son approche centrée sur les personnes victimes, la Commission a mis en place un groupe diversifié de personnes victimes d’agressions sexuelles au sein de l’Église, soit le « Groupe de discussion RA ». Ainsi pour ce rapport, la méthodologie de ce « Groupe de discussion RA » a été élargie à l’ensemble des quatre régions : Les Amériques, Afrique, Asie-Océanie et l’Europe.
En outre, des sessions individuelles d’écoute facilitées par des professionnels avec approximativement 40 personnes victimes ont eu lieu. « Les contributions de ces groupes ont servi de base pour développer des pratiques spécifiques destinées aux Églises locales — appelées “vademecum” ou manuel pratique — qui constituent des moyens de réparation cruciaux — au-delà du rôle limité, et souvent insuffisant, de la compensation financière dans le cadre d’une approche globale », dit-elle. Pour Émilie Rivet, « quand l’Église porte le souci de la Vérité en prenant le temps d’écouter les personnes victimes, quand elle se soucie de leur histoire, de leurs blessures et de l’impact des agressions subies sur toutes les dimensions de leur vie, alors elle se tient au cœur même de sa Mission : faire retentir la Bonne Nouvelle d’un Dieu qui libère, guérit et relève. »
Par ailleurs, l’un des points saillants du rapport 2024 concerne la nécessité de disposer de données fiables et vérifiables pour orienter efficacement les politiques de protection au sein de l’Église. Émilie Rivet avance que, comme l’a rappelé la juriste Maud de Boer-Buquicchio lors de la présentation du rapport, « des données fiables sont au cœur de tout effort de responsabilité, et leur absence compromet notre lutte contre les abus sexuels sur les enfants ».
Création d’un vadémécum opérationnel
À cet effet, l’analyse élargie menée cette année a mis en évidence plusieurs constats majeurs dont la persistance de défis dans la mise en œuvre des mesures de protection, la rareté des services d’accompagnement pour les victimes et survivants, ainsi qu’un manque de ressources et de capacités, particulièrement marqué dans les pays du Sud. Le rapport souligne aussi la nécessité d’un profond changement culturel au sein de l’Église et la reconnaissance de son rôle potentiel dans la promotion d’une culture de protection à l’échelle de la société, malgré les barrières culturelles encore nombreuses à la dénonciation.
En outre, le deuxième rapport annuel de la Commission Pontificale met en avant une série de conclusions et d’observations destinées à accompagner l’Église universelle dans son ministère de sauvegarde. Émilie Rivet nous explique que parmi les principales recommandations figure la création d’un vadémécum opérationnel à l’usage des personnes victimes.
Ce guide sera structuré autour de six axes notamment autour de l’existence de centres d’écoute accessibles et bienveillants, de la mise en place de services professionnels de soutien psychologique, de la reconnaissance publique et la présentation d’excuses officielles, d’un soutien financier adapté, d’une communication transparente et proactive avec les personnes concernées, ainsi que leur implication directe dans l’élaboration des politiques et procédures de sauvegarde. Ces mesures visent à consolider la responsabilité institutionnelle de l’Église tout en plaçant les victimes au cœur du processus de réforme, dit-elle.
Le document insiste également sur la nécessité d’un protocole clair et simplifié pour les cas de démission ou de destitution des responsables ecclésiastiques impliqués dans des affaires d’agression sexuelle ou de négligence, tout en respectant la confidentialité et la présomption d’innocence. Il préconise la création d’un réseau universitaire international dédié à la recherche sur les droits humains et la prévention des abus, afin de renforcer la collecte de données à travers les différentes régions du monde. Enfin, la Commission recommande de mettre en place un mécanisme de signalement systématique et obligatoire du ministère de sauvegarde au niveau local, en soulignant le rôle essentiel des nonces apostoliques pour soutenir, accompagner et encourager les efforts des Églises locales dans la mise en œuvre de ces réformes.
Le rôle de l’Église locale
Pour Émilie Rivet, avec ce deuxième rapport, « la Commission veut redire sa volonté profonde d’écouter et d’accueillir la parole des personnes victimes et survivantes, non seulement dans l’étape synodale, mais à chaque moment de son travail et de sa mission. Comme l’a exprimé Mgr Verny : “La Commission a à cœur de dire aux personnes victimes et survivant. e. s : nous voulons être à vos côtés.” En nous faisant proches des plus fragiles, en leur offrant notre attention, notre écoute et notre compassion, nous marchons au cœur même de la mission de l’Église : annoncer, par nos gestes et nos paroles, la Bonne Nouvelle qui guérit et relève. » De plus, le document relève d’autres points saillants, et « chaque section du Rapport annuel offre une analyse de plusieurs entités de l’Église comportant les éléments suivants : un profil détaillé ; un aperçu général des questions de sauvegarde ; les observations critiques de la Commission concernant les défis rencontrés par rapport à la sauvegarde et les recommandations de la Commission qui en résultent. »
Elle poursuit que la section 1 du rapport met l’accent sur le rôle de l’Église locale dans la mise en œuvre des politiques de sauvegarde, en soulignant la mission permanente de la Commission, organe stable de la Curie romaine, d’accompagner les Églises par trois voies : le processus ad limina, les demandes des conférences épiscopales ou instituts religieux, et celles des Groupes régionaux. Cette section vise à rendre compte des activités, défis et recommandations liés à la protection des mineur·e·s dans les différentes Églises locales.
En outre, pour chaque pays, les observations de la Commission s’appuient sur les données du Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant et les rapports des organisations de la société civile, permettant une vérification croisée des informations fournies par les autorités ecclésiales. Enfin, « pendant la phase synodale, méthodologie a été élargie afin d’inviter aussi le Nonce apostolique présent dans l’Église locale concernée à fournir un commentaire parallèle pendant la phase synodale. »
Des analyses ancrées dans les contextes culturels
Émilie Rivet souligne que la section 2 du rapport met en avant la mission de sauvegarde de l’Église dans les différentes régions du monde, nourrie par la proximité de la Commission avec les réalités locales grâce à ses membres et experts régionaux. Émilie Rivet explique que cette approche permet de recueillir des analyses ancrées dans les contextes culturels et pastoraux, tout en intégrant les contributions des victimes et survivants. L’étude sur les réparations révèle que, si certaines régions comme les Amériques, l’Europe et l’Océanie ont engagé des efforts significatifs, la tendance à privilégier la compensation financière limite une approche plus globale de la guérison.
Le rapport relève également le manque de ressources spécifiques pour soutenir les victimes. Par ailleurs, Émilie Rivet indique que« des pratiques de réparation prometteuses ont émergé de diverses Églises locales dans les régions, avec notamment une pratique de guérison communale traditionnelle dans les Tonga, connue sous le nom de Hu Louifi ; des rapports annuels détaillés sur les services d’accompagnement des victimes aux États-Unis ; des processus d’examen des lignes directrices concernant la sauvegarde qui sont en cours au Kenya, au Malawi et au Ghana ; et un remarquable rapport visant à lever le voile sur la vérité, Il coraggio di guardare, publié par le diocèse italien de Bolzano-Bressanone. »
Finalement, les sections 3 et 4 du rapport examinent la mise en œuvre des politiques de sauvegarde au sein de la Curie romaine et leur impact sur l’ensemble de l’Église. La Commission promeut une approche intégrée impliquant tous les niveaux de gouvernance, notamment à travers le travail du Dicastère pour l’Évangélisation, qui soutient les Églises locales dans les territoires missionnaires. Le rapport s’intéresse également au ministère de sauvegarde de l’Église dans la société, en particulier au sein des associations laïques supervisées par le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie.
Émilie Rivet indique qu’une méthodologie pilote a ainsi été élaborée pour accompagner ces organisations, avec l’exemple notable du Mouvement des Focolari, qui a mis en place une commission indépendante et des lignes directrices claires sur la prévention, la communication et la réparation des abus. Enfin, le rapport met en avant l’initiative Memorare, un programme destiné à renforcer les capacités de sauvegarde dans les Églises locales du Sud, déjà actif dans une vingtaine de pays et en pleine expansion. Pour conclure, Émilie Rivet soutient que la Commission réaffirme sa volonté de poursuivre l’intégration des contributions des victimes et survivants dans les prochains rapports annuels, non seulement durant la phase synodale, mais aussi à toutes les étapes du processus d’élaboration.



